Sâdhanâ
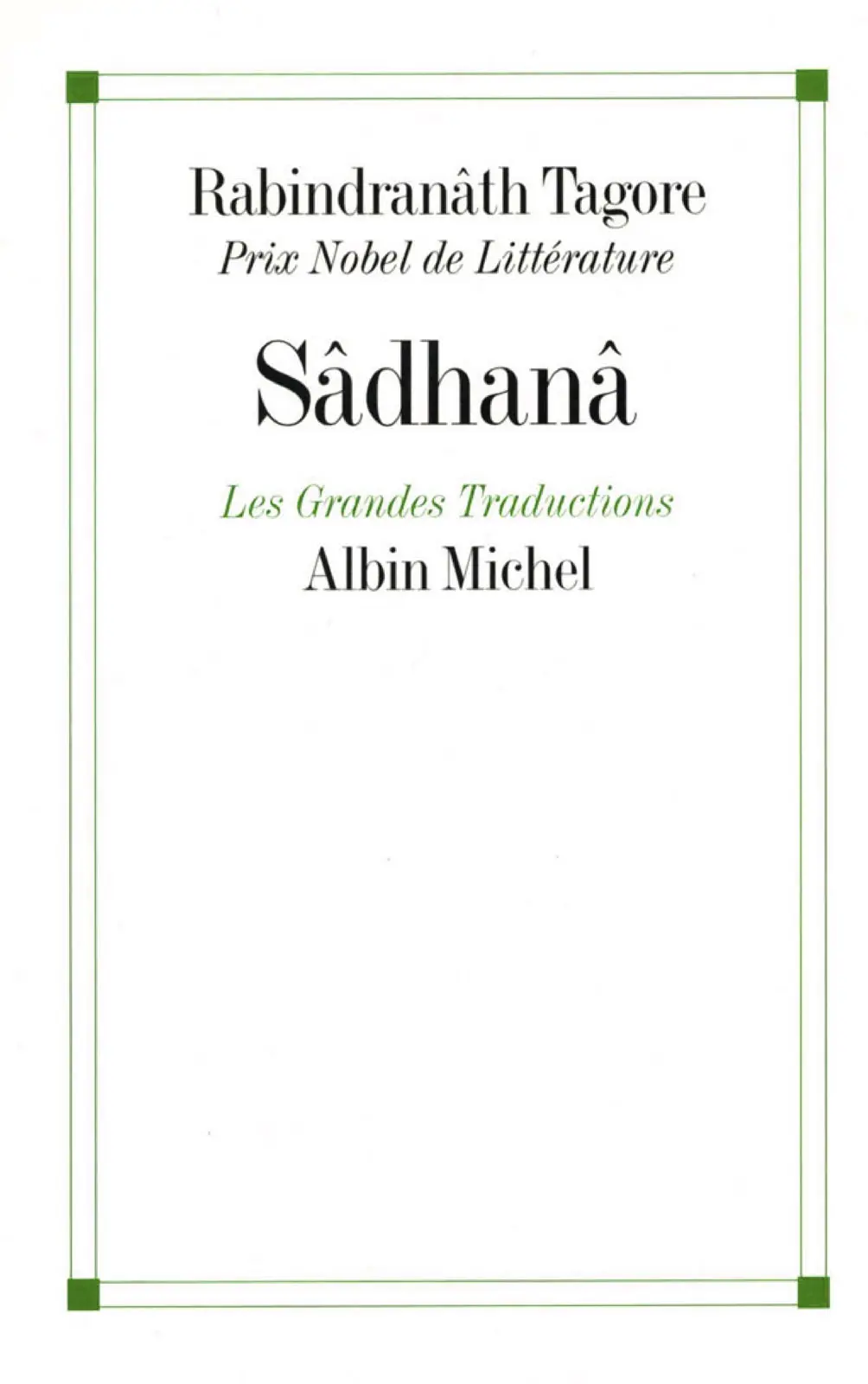
Première édition :
© 1940 par Jean Herbert
© Éditions Albin Michel, 1971
© Éditions Albin Michel, SA, 1996
ISBN : 978-2-226-28862-2

Centre national du livre
« Les Grandes Traductions »
Préface
DE tous les grands Maîtres hindous dont nous avons eu l’honneur de traduire et de publier les œuvres, le docteur Rabindranâth Tagore est certainement celui qu’il est le moins nécessaire de présenter au lecteur français. Sa renommée est établie depuis de longues années dans tout l’Occident aussi bien que dans son pays, et nombre de ses œuvres ont été traduites dans la plupart des langues de haute culture.
Dans l’Inde, où il est un peu irrespectueux de désigner par son nom une personnalité pour qui l’on éprouve une très haute estime, on appelle simplement Tagore « Le Poète ». Et il est bien en effet le poète par excellence de son Bengale et même de toute l’Inde moderne. Il ne le serait pas s’il n’avait puisé l’inspiration profonde de sa poésie et de tous les arts dont il est l’animateur aux sources vivantes de la spiritualité hindoue la plus vraie. En Occident, un artiste peut intéresser et même charmer son public en faisant appel presque uniquement aux ressources de l’intelligence et de la technique. Dans l’Inde, on se montre plus exigeant ; jadis le poète y était en même temps prophète, et, de nos jours encore, l’artiste doit y être avant tout le porteur d’un grand message spirituel, et consacrer à la diffusion de ce message toute la richesse d’expression dont il s’est rendu maître.
Quel est donc le message que nous apporte le grand Tagore sous le manteau souvent transparent de son verbe charmeur ? C’est l’enseignement de l’Inde éternelle, qui s’élève au-dessus de la vie matérielle, des philosophies et des religions, de la science et de l’art, et qui pourtant les embrasse tous – le même que nous retrouvons, « comme le fil dans un collier de perles », dans les Upanishads et la Gîtâ, chez Shankara et Chaitanya, et chez nos grands contemporains, Shrî Râma-krishna, Shrî Aurobindo et tous les autres.
De ce message, trop grand pour être exprimé par la parole humaine, chacun nous montre un ou plusieurs aspects de ce qu’il en a compris ou, comme on dit dans l’Inde, de ce qu’il en a « réalisé », de ce qu’il en a fait sien. Rabindranâth Tagore n’en a nulle part mieux exprimé sa version, à l’usage du public occidental, que dans le petit ouvrage que nous présentons aujourd’hui : Sâdhanâ.
Dans ces pages, où l’auteur se défend d’avoir fait œuvre de savant ou même de philosophe, on sent battre le cœur des foules innombrables de l’Inde, pour qui le Divin, plus réel que l’homme de chair et d’os, est le but, la raison d’être, la réalisation. Le texte en a été puisé dans des causeries faites par le Poète à ses élèves à Bolpur. Il n’est pas sans intérêt de rappeler maintenant que, publiées quelques mois avant la guerre de 1914-1918, elles jurent l’objet de neuf éditions successives avant que l’armistice fût signé. Sans doute serait-ce déjà là une raison suffisante pour en publier une traduction française sans attendre la fin de la guerre actuelle.
Le mot sanskrit sâdhanâ désigne actuellement dans toutes les langues de l’Inde une ascèse, de n’importe quel ordre, à laquelle on se soumet rigoureusement pour progresser dans la voie spirituelle.
Aux armées, 1939.
Jean HERBERT.
I
L’individu et l’univers
JADIS, en Grèce, la civilisation s’épanouissait à l’abri des murs de la cité. En fait, des murailles ont défendu le berceau de toutes les civilisations modernes.
Cette protection matérielle a laissé dans l’esprit des hommes une profonde empreinte. Elle a introduit dans nos conceptions mentales le principe de « diviser pour régner », qui fait naître en nous l’habitude d’assurer toutes nos conquêtes en les entourant de murs et en les séparant les unes des autres. Nous isolons chaque pays des autres pays, nous subdivisons nos connaissances en compartiments étanches, nous discriminons entre l’homme et la nature. D’où chez nous de graves soupçons à l’égard de tout ce qui est au-delà des barrières que nous avons construites ; les éléments extérieurs doivent livrer une âpre bataille pour obtenir que nous les admettions.
Lorsque les premiers envahisseurs âryens firent irruption dans l’Inde, notre pays était couvert de forêts et les nouveaux arrivants surent bientôt en tirer profit. Ces forêts les protégèrent contre le soleil brûlant et les orages dévastateurs des pays tropicaux ; elles leur donnèrent du fourrage pour leurs troupeaux, du bois pour les feux du sacrifice, des matériaux pour construire les cabanes. Les tribus âryennes, guidées par leurs patriarches, s’installèrent dans différentes régions boisées où elles trouvaient une protection suffisante, de la nourriture et de l’eau en abondance.
Ainsi dans l’Inde notre civilisation prit naissance au cœur des forêts, et reçut de cette origine et de ce milieu un caractère particulier. Entourés par la nature vivante, nourris et vêtus par elle, nous avons conservé avec ses différents aspects le commerce le plus étroit et le plus constant.
On pourrait penser qu’une telle vie dût avoir pour effet d’émousser l’intelligence humaine, d’abaisser le niveau d’existence et d’affaiblir ainsi tout ce qui nous pousse vers le progrès. Dans l’Inde ancienne pourtant, nous constatons que les conditions de vie dans la forêt ne triomphèrent pas de l’intelligence humaine et n’amoindrirent pas l’énergie de l’homme, mais leur donnèrent une orientation spéciale. Continuellement en contact avec la vie et la croissance de la nature, l’homme n’éprouvait nul désir d’étendre son domaine et d’entourer de murs ce qu’il avait acquis. Son but n’était pas d’amasser, mais de « réaliser », d’élargir sa conscience en se développant avec son milieu et en y pénétrant toujours plus profondément. Il sentait que la vérité doit tout embrasser, que dans la vie l’isolement absolu est impossible, et que le seul moyen d’atteindre la vérité est de s’incorporer à tout ce qui existe. Réaliser cette vaste harmonie entre l’esprit de l’homme et l’esprit de l’univers était dans l’Inde antique le but des sages qui habitaient les forêts.
Plus tard, les forêts vierges firent place à des champs cultivés ; de riches cités s’élevèrent de tous côtés ; de puissants royaumes se constituèrent, qui furent en rapport avec tous les grands empires du monde. Cependant, même à l’apogée de la prospérité matérielle, le cœur de l’Inde conserva toute son adoration pour l’ancien idéal de laborieuse réalisation du Moi, pour la vie simple et digne dans les sylvestres ermitages, et puisa ses plus riches inspirations dans la sagesse qu’on y avait accumulée.
L’Occident se glorifie, semble-t-il, de penser qu’il dompte la nature – comme si nous vivions dans un monde hostile, où nous devions arracher tout ce qui est nécessaire à un ordre de choses étrange et récalcitrant. Ce sentiment est le résultat des habitudes et de l’éducation acquises dans l’enceinte des villes. Dans la vie de la cité, l’homme dirige tout naturellement le faisceau concentré de sa vision mentale sur sa propre vie et son propre travail, et il en résulte une dissociation artificielle entre lui-même et la Nature Universelle au sein de laquelle il repose.
Dans l’Inde, le point de vue était différent ; l’homme et le monde étaient englobés en une seule grande vérité. L’Inde insista de toute son énergie sur l’harmonie qui existe entre l’individuel et l’universel. Elle sentit que nous ne pouvions avoir aucune communication avec le monde environnant si celui-ci nous était complètement étranger. Ce que l’homme reproche à la nature, c’est qu’il doit acquérir par ses propres efforts presque tout ce qui lui est nécessaire. C’est vrai, mais ses efforts ne sont pas vains ; l’homme récolte des succès tous les jours, et cela montre qu’il existe entre lui et la nature une relation rationnelle, car nous ne pouvons jamais rien faire nôtre qui ne nous soit déjà véritablement rattaché.
Nous pouvons envisager une route sous deux aspects différents. Nous pouvons y voir ce qui nous sépare de l’objet de nos désirs, et alors chaque pas que nous faisons dans notre marche est du terrain conquis de force en dépit des obstacles.
1 comment