Correspondance
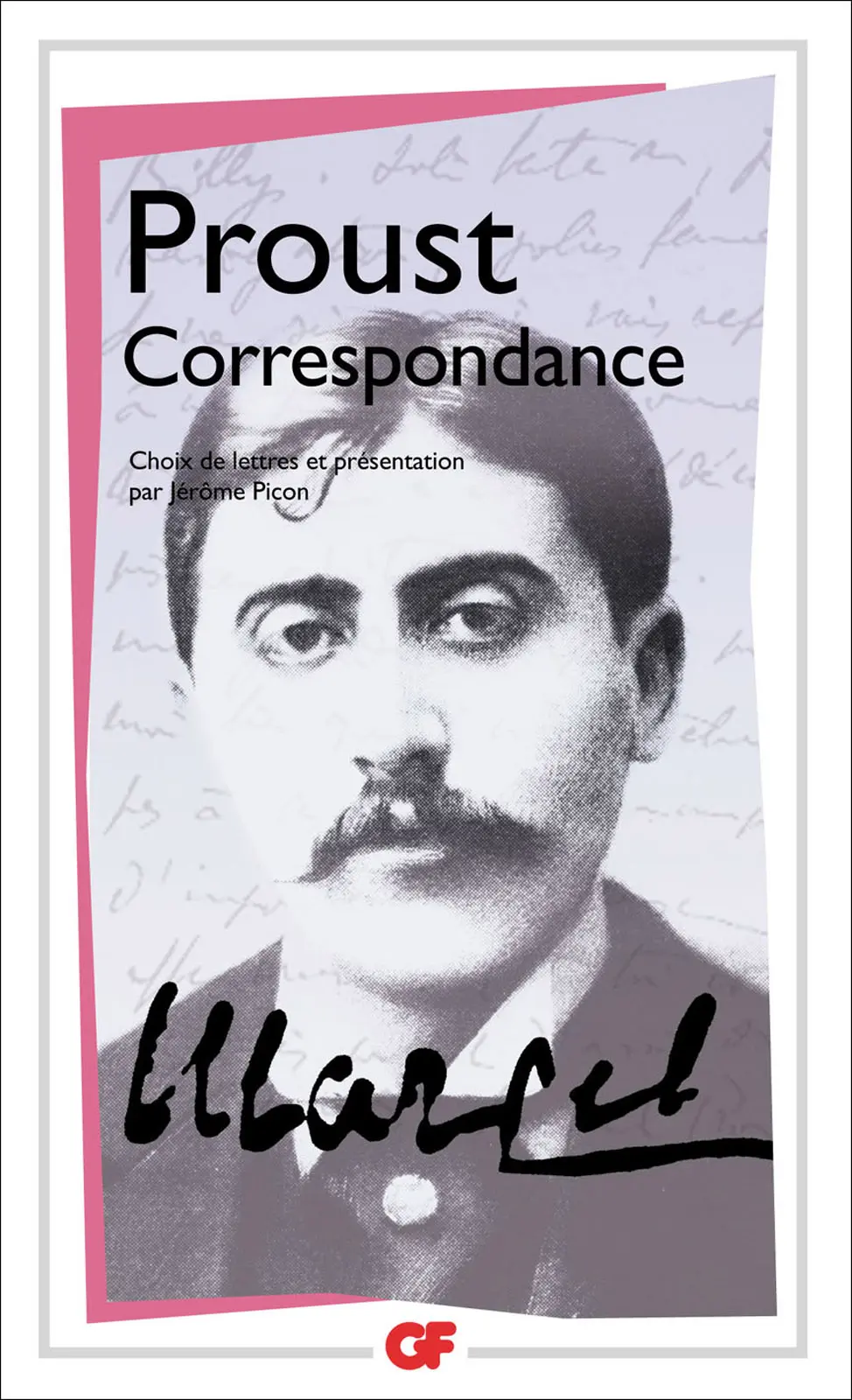
PRÉSENTATION
CE SECOND VISAGE
On s’écrit beaucoup, dans la Recherche du temps perdu. Dès l’ouverture, la supplique du Narrateur enfant à sa mère afin qu’elle monte l’embrasser dans sa chambre, contre l’avis du père qui juge le rite absurde, d’un trait complète l’armure mélancolique et marque le vrai départ du roman, lorsque la durée indéfinie des premières notations à l’imparfait – « j’entendais le sifflement des trains », « je me réveillais », « j’étais dans ma chambre »1 – rétrécit à celle instantanée du passé simple : « j’eus un mouvement de révolte, je voulus essayer une ruse de condamné. J’écrivis à ma mère2 ». Adolescent, c’est une lettre que le Narrateur, se disant amoureux de Gilberte Swann, décide d’adresser au père de celle-ci pour protester de ses sentiments. Et jeune homme, une lettre encore, qu’il trace dans l’espoir d’attirer l’attention du peintre Elstir, un soir, dans le restaurant de Rivebelle. Plus loin, les relations du protagoniste avec Albertine sont jalonnées de messages à écrire, de missives mystérieuses, libératrices ou accablantes, où résonne l’écho d’autres messages, d’autres missives. Car aux lettres écrites et reçues s’ajoutent celles citées de biais, projetées, attendues ou épiées – lettres de Proudhon, offertes à Saint-Loup par la grand-mère du Narrateur ; lettre de Gilberte au Narrateur, que celui-ci se plaît « à imaginer3 » jusqu’à la composer lui-même ; lettre d’Odette de Crécy à Forcheville, interceptée et longuement scrutée par Swann... : en tout plusieurs dizaines de billets, de cartes, de télégrammes4 dont la découverte, le commentaire ou la simple évocation amorcent un rebondissement, dessinent un tournant de l’action.
Autant de moments du livre où cependant le cours des choses est suspendu. Un monde se referme ; rien n’est plus de tout ce qui aurait pu être tant qu’on gardait « la plume en main5 ». Mais de résolution, aucune : ce qui a été écrit n’est qu’« un destin qui poursui[t] seul sa route6 ». L’impatience et l’angoisse du petit garçon devant l’interdit, une fois le message confié à la bonne pour être porté, laissent place en lui à de sereins espoirs où les conséquences de sa désobéissance semblent aussi peu envisagées que les chances d’arriver à ses fins premières, obtenir de sa mère une visite, un baiser : devenu billet lui-même, désormais il se livre au songe d’« entrer invisible et ravi dans la même pièce7 » qu’elle. La déclaration à Charles Swann, de son côté, n’arrache à celui-ci qu’un « hauss[ement d’]épaules8 », tandis qu’Elstir, sitôt lue celle qui lui est destinée, la glisse dans sa poche et « continue [...] à dîner9 ». Quant à la lettre d’Odette de Crécy à Forcheville, elle permet à Swann, tout occupé à décrypter par transparence le texte sous l’enveloppe, de subordonner aux incertitudes de cette enquête la démonstration de l’infidélité par ailleurs avérée de sa maîtresse. Comme une étape dans la douloureuse expérience qu’elle prépare, du décalage non plus entre l’écriture et la lecture, entre l’adresse et la réception, mais entre les êtres, dans le temps, la lettre installe l’attente, elle autorise le doute.
Distance, rêverie
Simple sursis ? Esquisse d’un ailleurs intact ? Une ambiguïté comparable traverse la correspondance de Marcel Proust où alternent, sous le calcul du moment précis où le destinataire de telle lettre en prendra connaissance, le frisson, pour l’écrivain, de devenir cet « irréel étranger assis malgré vous près de votre lit si vous lisez cette lettre couché10 », et la certitude qu’il ne lui sera ni utile, ni possible de se faire comprendre, laquelle est souvent développée, non sans bonheur comique, jusqu’à l’absurde – « Je venais te demander si tu voulais venir déjeuner ? interroge Proust, mais je vois que tu ne rentreras pas à temps11 » ; « Je voudrais ne pas avoir écrit cette lettre et ne l’enverrai peut-être pas12 » ; « Je ne vous écris ce petit mot que pour vous dire que je vais vous écrire [...] Je vous écrirai demain13 » ; « J’ai des choses importantes à vous dire. Malheureusement comme je suis sorti ce soir (c’est même ce qui fait que j’ai des choses importantes à vous dire) je serai demain mercredi (aujourd’hui quand vous recevrez ce mot) en pleine crise et ne pouvant recevoir14. » Contradiction d’horaire ou de calendrier, conflit d’aspirations, doute, regret, rien ne manque de ce qui peut différer ou compromettre la rencontre, c’est-à-dire l’épreuve, sur le discours, de la réalité. Au point qu’ici se configure un espace neuf, fermé à toute circulation et, suivant la formule de Vincent Kaufmann, proprement « impartageable15 », dont Proust exploite la physique de fantaisie pour échafauder telles représentations auxquelles il finit par demeurer lui-même étranger : chacun des panoramas qu’il brosse d’une catastrophe imminente, de sa santé ou de ses finances, régulièrement refermé sur l’engagement de ne rien changer à la vie qu’il mène, chaque « plaisir profond » qu’il rapporte, entaché de « perplexités »16, chaque soupçon qu’il articule, de trahison ou d’infidélité à sa personne, anéanti par un « je ne crois pas tout cela17 », manifestent un même mépris d’être compris, presque une déclaration d’obscurité, un défi au lecteur de bonne volonté. Destinataire et lecteur à son tour, Proust goûte au demeurant les délices de l’équivoque lorsque, reparcourant une missive de son ami Léon Yeatman, il s’aperçoit combien différemment il l’avait interprétée une première fois, et en vient à conclure : « C’était charmant des deux façons18. »
Lire une lettre, c’est ainsi renoncer à savoir la vérité, comme en écrire une, à la dire. La conclusion du Narrateur devant le « peu qu’il y a d’une personne dans une lettre19 » rejoint celle de Proust, refusant la pleine paternité de ce qu’il vient de tracer : « [J]e sens que je fausse un peu ma pensée, en la figeant dans une lettre20 », prévient celui-ci dans le post-scriptum d’un long billet à Robert de Montesquiou. Mais à la souffrance du héros de roman, finalement jamais que soulagée par l’écran de papier, correspond chez l’écrivain un tout autre sentiment, d’impunité et de hauteur. « Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse », dit le poète21, et Proust avec lui, qui cite le vers sa vie durant à la manière d’un leitmotiv toujours plus paradoxal22 : sous l’affiche du retrait comme ailleurs sous les politesses, les révérencieuses mises en garde et une infinie palette d’esquives, Proust prend figure de démiurge accompli, absent de son propre discours.
Éloquence, fiction
Une semblable toute-puissance à redessiner, à figer le monde, n’est certes pas sans danger. Car l’« éloquence », à l’origine des « beautés » de bien des lettres, sert d’abord à « couvrir les défaillances du caractère » : des années après avoir écrit « une lettre injuste à Maman », le souvenir s’en retourne, perçant, contre lui, si bien que Proust aimerait mieux « l’avoir reçue qu’écrite »23. La pente fictionnelle de sa correspondance aide aussi à comprendre l’étonnante maladresse des démarches qu’effectue le romancier en vue de la publication de la Recherche du temps perdu, d’abord en 1909 sous la forme d’un feuilleton dans Le Figaro, puis trois ans plus tard, lorsqu’il est question d’un, de deux, de trois volumes chez Fasquelle ou aux éditions de la Nouvelle Revue Française – l’ouvrage, à ce moment, s’intitule Les Intermittences du cœur. Comptant qu’un premier volume verra le jour dans les deux mois, et désireux de préparer l’événement par quelque annonce et prépublication, Proust fait tenir en novembre 1912 des pages de son livre à Jacques Copeau, jeune directeur de rédaction de la revue La Nouvelle Revue française, en lui marquant combien il souhaiterait les y voir paraître. « De toutes façons, pose-t-il, c’est de toutes les Revues celle où il me serait le plus agréable d’être lu ; mais ce me sera plus précieux encore, et comme une consolation, si ce livre n’est pas édité chez vous, soit que je ne puisse faire les démarches nécessaires pour reprendre ma liberté vis-à-vis de mon premier éditeur (je suis toujours alité), soit que, même le pouvant, la réponse que doit me donner M. Gallimard soit négative24 » : derrière la pénible casuistique de l’échec – car toutes les infortunes possibles sont ici contemplées, jusqu’à celle fondamentale de la santé mauvaise –, le soin d’en donner une vue complète et logique apparaît comme un pur jeu d’écriture. À la veille de Noël, Proust apprend coup sur coup que les éditions de la Nouvelle Revue Française et Fasquelle refusent de publier son livre. N’ont-elles été assez rebutées par les mises en garde qu’il vient lui-même d’élever, assurant tour à tour que son livre « est ce qu’on appelait autrefois un ouvrage indécent25 », et qu’il « a déjà un éditeur26 » ? Dans une lettre à Louis de Robert, Proust tire quelques conclusions, toujours en forme de fantasmagorie : « le point de vue de Fasquelle, parfaitement juste commercialement, n’est même pas bête au point de vue littéraire [...]. Je le crois faux, mais on peut se tromper d’une manière intelligente. Donc [...] je ne songe plus qu’à faire éditer le volume à mes frais. Non seulement je paierais les frais mais malgré cela je voudrais intéresser l’éditeur aux bénéfices s’il y en avait27 ».
Plus heureuse s’avère la manœuvre, au milieu de la guerre de 1914, pour reprendre Du côté de chez Swann à l’éditeur qui a finalement accepté de le faire paraître à compte d’auteur, Grasset, et confier les volumes restants de la Recherche aux éditions de la Nouvelle Revue Française – Gallimard s’étant entre-temps ravisé. Chargé d’approcher Bernard Grasset, lequel par ces temps de combats se trouve dans la peu avouable position de pensionnaire d’une clinique en Suisse, René Blum compose une lettre en fait inspirée, relue et commentée par Proust : « Tel que c’est, écrit Proust, je l’envoie, parce que le nombre des imperfections ne me paraît pas dépasser celui auquel il faut toujours sagement s’attendre. Je ne devrais même vous en signaler aucune, puisque ce n’est que rétrospectif (car ma lettre, ou plutôt votre lettre sera partie quand celle-ci vous arrivera)28. » Et comme s’il ne lui suffisait de poser au faussaire, Proust prétend encore pénétrer l’autre à son insu, flattant Blum d’un « vous avez eu parfois en vous [...] un Marcel Proust intérieur29 » – le décrochement d’avec soi-même est complet.
Aussi la lettre, nouvelle « cosa mentale » pour le Narrateur qui en dispose comme d’un « objet de rêverie »30, pour l’écrivain n’est pas seulement un miroir tendu où se figurer sous la forme de mots, de récits et d’arguments, mais aussi un relais de cette vision, dans l’attente de trouver, par-delà le destinataire déclaré, solliciteur ou confident de passage, son véritable public.
1 comment