De profundis Read Online
Présentation de l’éditeur |
|
|
25 mai 1895. Oscar Wilde, dramaturge admiré du Tout-Londres et amant de lord Alfred Douglas, est condamné à deux ans de travaux forcés pour « outrage aux mœurs ». Début 1897, l’écrivain brisé, réduit au sinistre matricule « C.3.3. », obtient enfin du directeur de la prison de Reading l’autorisation d’écrire. La longue lettre qu’il rédige alors à l’intention de Douglas, à qui il reproche de l’avoir abandonné, ne sera publiée, partiellement, que cinq ans après sa mort : récit autobiographique et méditation existentielle sur l’art et la douleur, De profundis est aussi l’un des plus beaux témoignages qui soient sur la passion. Quant à La Ballade de la geôle de Reading (1898), inspirée d’une histoire vraie, elle retrace les derniers jours d’un soldat exécuté pour avoir égorgé sa femme par jalousie. Ce poème poignant est le chant du cygne de Wilde, qui mourut deux ans après sa publication. |
|
Du même auteur
dans la même collection
L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT (édition bilingue avec dossier).
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY.
LE PORTRAIT DE MR W.H., suivi de LA PLUME, LE CRAYON ET LE POISON.
SALOMÉ (édition bilingue avec dossier).
UN MARI IDÉAL (édition bilingue avec dossier).
De profundis
La Ballade de la geôle
de Reading
Présentation
« Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition. »
MONTAIGNE,
Essais, livre III, chapitre II.
De profundis
Genèse de l’œuvre
En ce 25 mai 1895, Oscar Wilde, dramaturge admiré du Tout-Londres et amant du plus jeune fils du marquis de Queensberry, lord Alfred Douglas – surnommé Bosie par ses proches –, et de bien d’autres jeunes gens qu’il rencontrait et fréquentait occasionnellement dans des lieux plus ou moins publics, fut condamné à deux ans de travaux forcés pour « outrage aux mœurs », à l’issue d’un procès ignominieux et perdu d’avance1. Un an plus tard, en juin 1896, après qu’il eut passé huit mois à Reading, où il était enfermé depuis novembre 1895, et qu’il eut déjà purgé quatorze mois de sa peine dans des conditions abominables2, l’écrivain brisé, privé de nom et réduit à un sinistre matricule, C. 3. 3., vit sa situation s’améliorer un tant soit peu : le directeur de la prison, Henry Bevan Isaacson, personnage aussi haineux qu’obtus, fut affecté à un nouveau poste et remplacé par un certain James Osmond Nelson, notoirement plus humain. Celui-ci prit diverses mesures appréciées de l’ensemble des détenus, parmi lesquelles la réduction des punitions, jusque-là infligées pour des motifs la plupart du temps stupides (une cellule mal balayée, quelques paroles échangées avec un codétenu), et celle des châtiments corporels. Il tint aussi à rencontrer Wilde, et se prit de sympathie pour lui. Sensible à son désespoir et indigné qu’on lui refusât même de l’encre et du papier, il fit en sorte que Wilde pût écrire à sa guise, ou à peu près (l’écrivain devait se limiter, comme tous les autres détenus, à de la correspondance privée, seule admise), et disposer des livres que, jusqu’alors, on lui avait refusés. C’est à ce moment-là que germa en Wilde l’idée de rédiger une lettre à l’intention du jeune homme qu’il avait tant aimé et qui l’avait si mal payé de retour. Pour autant, les conditions matérielles étaient loin d’être idéales. En effet, il n’était autorisé à rédiger qu’une page à la fois, le feuillet (du papier administratif de couleur bleue) lui étant retiré une fois terminé. Celui-ci était alors remplacé par un autre, sans que l’auteur pût relire ce qu’il avait écrit la veille.
Wilde commença à travailler en janvier 1897, jusqu’en mars de cette même année, et il eut rapidement l’idée de sortir sa lettre de la sphère privée. Pourquoi ne pas la publier, se demanda-t-il, s’inscrivant ainsi dans la lignée d’autres écrivains persécutés, non moins illustres et tout aussi malheureux ? Ovide, par exemple, qui, chassé de Rome par l’empereur Auguste (parce que, dit-on, son Art d’aimer lui avait déplu), et assigné par lui à résidence dans la ville de Tomes sur la mer Noire, adressa pendant dix ans à ses amis des poèmes épistolaires, les Tristes et les Pontiques, où s’exprime la douleur de l’exilé. Mais Wilde avait une autre idée en tête, non moins gratifiante et bien plus malicieuse. Ne l’avait-on pas présenté comme un être pervers habité par les plus obscures forces du mal ? Eh bien, il endosserait, par jeu et par défi, un autre costume, celui du prêtre et, pourquoi pas, celui du servant suprême, le pape en personne ! « C’est véritablement une encyclique et, à l’instar des bulles du Saint-Père que l’on désigne par leurs premiers mots, on pourra en parler comme de l’Epistola : In carcere et vinculis [soit Lettre en prison, et dans les chaînes] », écrivit-il à son ami Robert Ross le 1er avril 18973. Ce titre n’était pas de lui puisqu’il l’avait emprunté à Horace dont, en bon latiniste, il connaissait les Épîtres et les Odes, mais il lui plut d’imaginer, l’espace d’un instant, que pussent se rencontrer sous sa plume, pour son bon plaisir et pour le suprême déplaisir de ses détracteurs, le souverain pontife et le grand poète païen. Wilde redressait la tête, et cette tâche eut sur lui d’heureux effets thérapeutiques :
Des très nombreuses choses pour lesquelles je doive remercier le directeur de la prison, il n’y en a pas pour laquelle je lui sois plus reconnaissant que de m’avoir permis d’écrire à A. D. [sic], et autant que je le désirais. Pendant deux ans ou presque, j’ai porté en mon cœur un fardeau d’amertume, plus lourd de jour en jour, et je suis enfin parvenu à me débarrasser de la plus grande partie4.
Que devint cette lettre ? Son auteur voulait qu’elle fût expédiée depuis Reading à son destinataire, comme il en avait fait la demande auprès de Nelson. Celui-ci n’y était pas hostile, mais il ne pouvait prendre seul cette décision, Wilde, en outre, n’étant pas un prisonnier ordinaire. Aussi le directeur se référa-t-il le 2 avril à ses supérieurs, à qui il soumit la requête du détenu : leur réponse fut négative. Ils se contentèrent de lui demander de conserver soigneusement le manuscrit et de le remettre à son auteur à sa libération. C’est ce que fit Nelson, qui avait par ailleurs conscience de détenir un document d’importance. Une fois libéré, le 19 mai, son manuscrit sous le bras, Wilde s’empressa de quitter l’Angleterre pour toujours : le 20, il débarquait à Dieppe, où l’attendait Ross à qui il confia son « épître ».

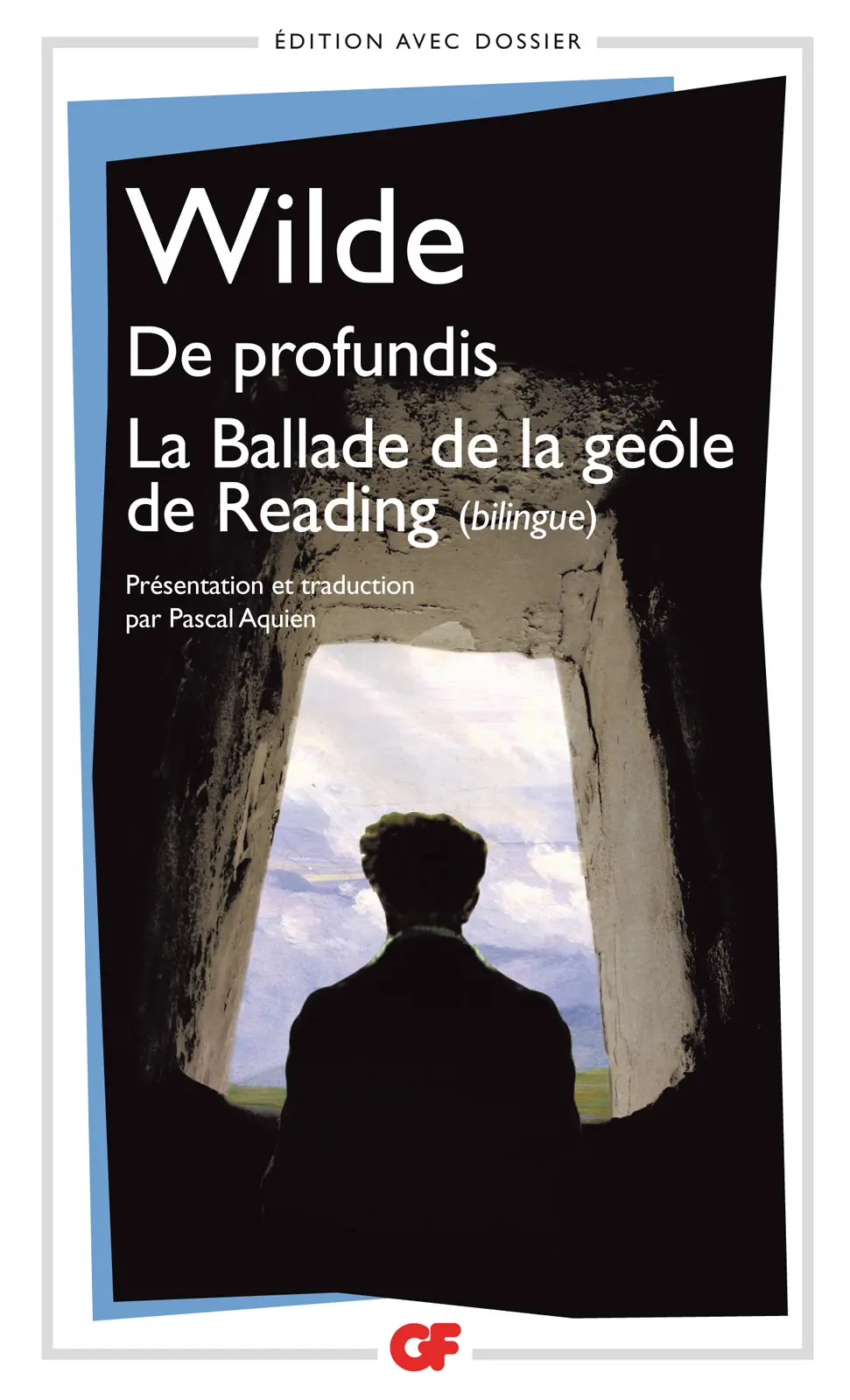
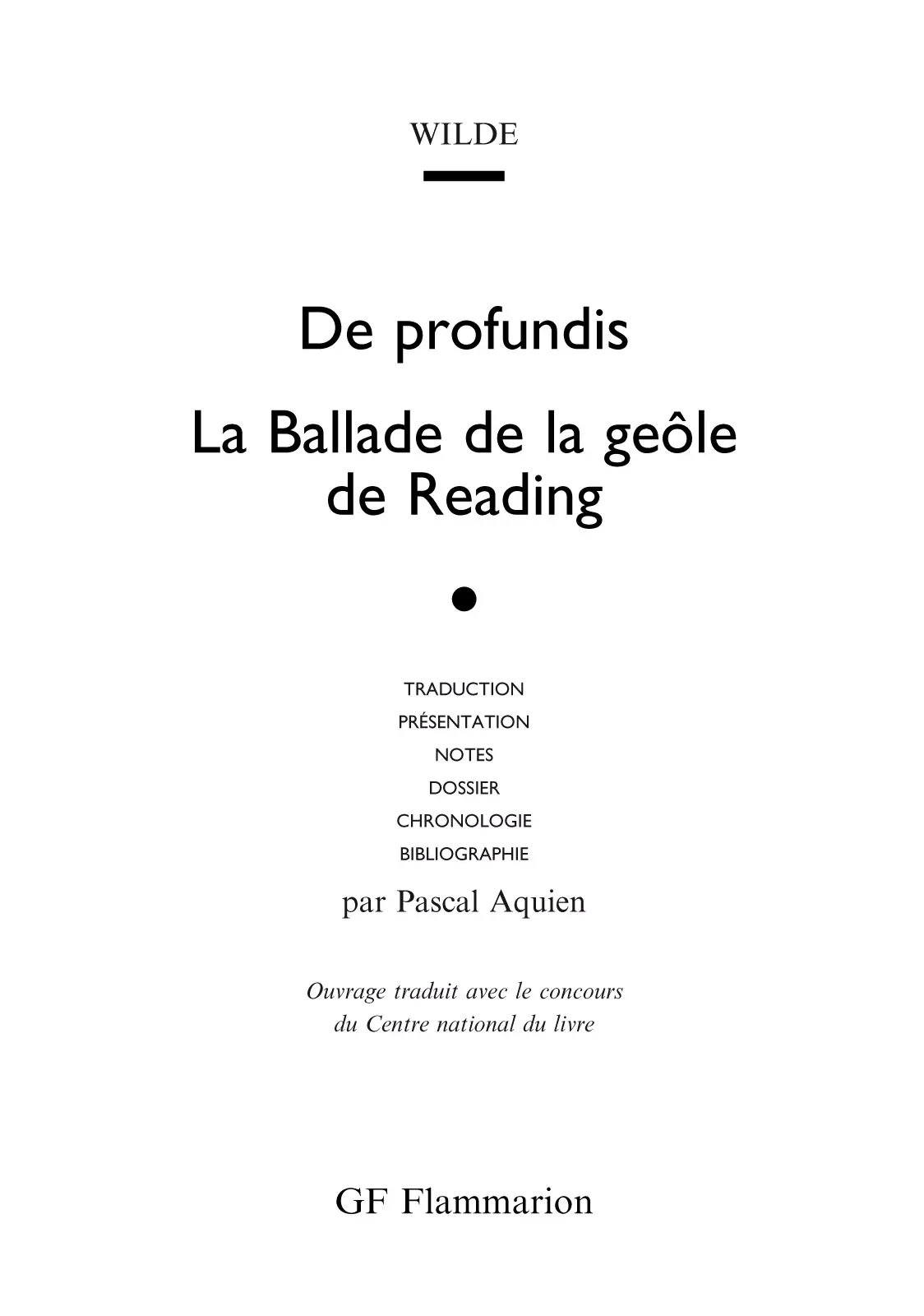

1 comment