L origine des especes Read Online
|
Présentation de l’éditeur |
|
|
La publication de L’Origine des espèces, en 1859, a marqué une révolution intellectuelle comparable à celle qui est associée aux noms de Copernic et Galilée. En proposant une théorie de la « descendance avec modification » et de la « sélection naturelle », Darwin apportait des réponses aux questions qui préoccupaient les naturalistes de son époque. Le caractère radical de ces réponses aussi bien que les problèmes qu’elles laissaient en suspens ont alimenté d’emblée polémiques et controverses. De là les ajouts et les digressions qui, au gré des six éditions successives de l’œuvre, en vinrent à obscurcir le propos d’origine. En élaguant la traduction d’Edmond Barbier de ce qui ne figurait pas dans l’édition de 1859 et en y rétablissant ce qui en avait disparu, le présent volume permet au lecteur francophone de retrouver cette œuvre dans sa fraîcheur initiale. |
|
|
|
|
|
|
|
L’ORIGINE DES ESPÈCES
PRÉSENTATION
L’Origine des espèces a valu à Darwin une célébrité qui s’étend bien au-delà des cercles professionnels de la biologie et de l’histoire des sciences, et la date de parution de sa première édition, 1859, est souvent considérée comme la date de naissance de la théorie de l’évolution1. Tout cela ne va pas sans quelque simplification. Darwin n’est pas l’homme d’un seul livre. En dehors de L’Origine des espèces et du récit de son voyage autour du monde, on lui doit une douzaine d’autres ouvrages qui portent sur des sujets aussi divers que la formation des récifs de corail, le mouvement des plantes grimpantes, la fécondation des orchidées ou le rôle des lombrics dans la formation de la terre végétale. La théorie de l’évolution n’est pas non plus l’œuvre d’un seul homme. On sait qu’un autre naturaliste anglais, Wallace, était arrivé, indépendamment de Darwin, à des conclusions analogues. Avant eux, l’opinion selon laquelle les végétaux et les animaux n’ont pas toujours eu l’aspect que nous leur connaissons avait été émise par plusieurs auteurs. Certains, à la suite de Lamarck, défendaient une théorie complète de la transformation des espèces, mais d’autres auparavant, tels Buffon, Benoît de Maillet ou Érasme Darwin (le grand-père de Charles) avaient déjà émis quelques doutes sur la fixité des espèces ou imaginé, sur le mode ludique, une transformation des formes vivantes2. Ni les uns ni les autres n’utilisaient le terme d’évolution, qui n’a longtemps évoqué que le développement individuel d’une structure préexistante ; mais Darwin lui-même évite ce mot, lui préférant systématiquement l’expression « descendance avec modification3 ».
Pourtant, et malgré toutes les nuances qu’il convient d’apporter, l’histoire rejoint ici la légende, et confirme que L’Origine des espèces marque une étape décisive non seulement dans les sciences de la nature, mais aussi dans la vie intellectuelle en général. Il y a plusieurs manières d’en mesurer la portée et d’en apprécier la signification. On peut l’inscrire dans la longue durée d’une tradition qui remonte aux savoirs naturalistes du XVIII e siècle. On peut l’insérer dans une perspective biographique pour montrer comment se mêlent l’histoire d’une vie et la construction d’une œuvre. On peut enfin s’attacher aux multiples querelles, scientifiques, religieuses et politiques qu’elle a suscitées.
I. Histoire naturelle et théorie de l’évolution
a) Histoire naturelle et naturalistes avant Darwin
L’histoire naturelle occupe au XVIII e siècle une place centrale dans la culture, en Grande-Bretagne comme sur le Continent. Faut-il rappeler que le mot « histoire » n’implique nullement ici l’idée de déroulement temporel que nous serions tentés d’y mettre, mais qu’il est seulement à prendre au sens étymologique : enquête, recherche d’information. En deçà de toute historicité, l’histoire naturelle n’est encore qu’une description des trois règnes : animal, végétal et minéral. Cette description est rendue urgente et difficile par le nombre sans cesse croissant d’espèces jusqu’alors inconnues qui arrivent en Europe. Jardins et collections s’emplissent de spécimens de plantes et d’animaux. Certains végétaux prennent place parmi les plantes cultivées en Europe pour l’alimentation ou pour l’ornement, tandis que d’autres, tel le café, se voient transportés d’une colonie à l’autre ; tous, et même ceux, les plus nombreux, qui n’intéressent que les naturalistes, changent, par leur accumulation, l’image du monde vivant. À l’intérieur des pays européens eux-mêmes les campagnes sont parcourues par des amateurs passionnés, leur flore et leur faune minutieusement observées. Les espèces végétales qui se comptaient par centaines au début du XVI e siècle se comptent par milliers au XVII e siècle, par dizaines de mille au tournant du XVIII e et du XIX e siècle. Cet effet de masse multiplie les risques de double emploi dans les descriptions et rend obsolète le recours à l’ordre alphabétique. Par là il impose la recherche d’une nomenclature et d’une classification sur lesquelles tous les naturalistes puissent se mettre d’accord pour nommer et classer toutes ces espèces suivant les mêmes règles. C’est précisément ce que se propose de réaliser Linné qui, à cet égard, fait figure de modèle.
De l’œuvre du naturaliste suédois, la postérité a retenu essentiellement la nomenclature binominale – fixée dans le Species plantarum en 1753 et dans la dixième édition du Systema naturae en 1758, et encore en usage aujourd’hui – qui permet de désigner chaque espèce par un nom générique complété par un adjectif, ou un substantif, spécifique. Ainsi l’Érable champêtre s’appelle Acer campestre, et le Sycomore Acer pseudo-platanus ; la Mésange charbonnière Parus major, et la Mésange bleue Parus caerulus. Pour ses contemporains, cependant, le prestige de Linné n’est pas seulement lié à cette codification mais aussi à sa classification du règne végétal fondée sur le nombre des organes sexuels visibles dans la fleur. Ce système qui ne fait appel qu’à un seul critère est relativement facile à utiliser mais il aboutit à réunir dans la même classe des espèces qui peuvent n’avoir d’autre point commun que le nombre de leurs étamines ; aussi, dès la fin du XVIII e siècle on le voit reculer devant la concurrence de la méthode des familles naturelles, dont le principe est de regrouper par familles les genres qui se ressemblent le plus, sans hésiter pour cela à faire appel à plusieurs critères.
Pour former ces familles naturelles, la méthode exposée par Antoine Laurent de Jussieu en 1789 dans le Genera plantarum repose sur la pondération des caractères.

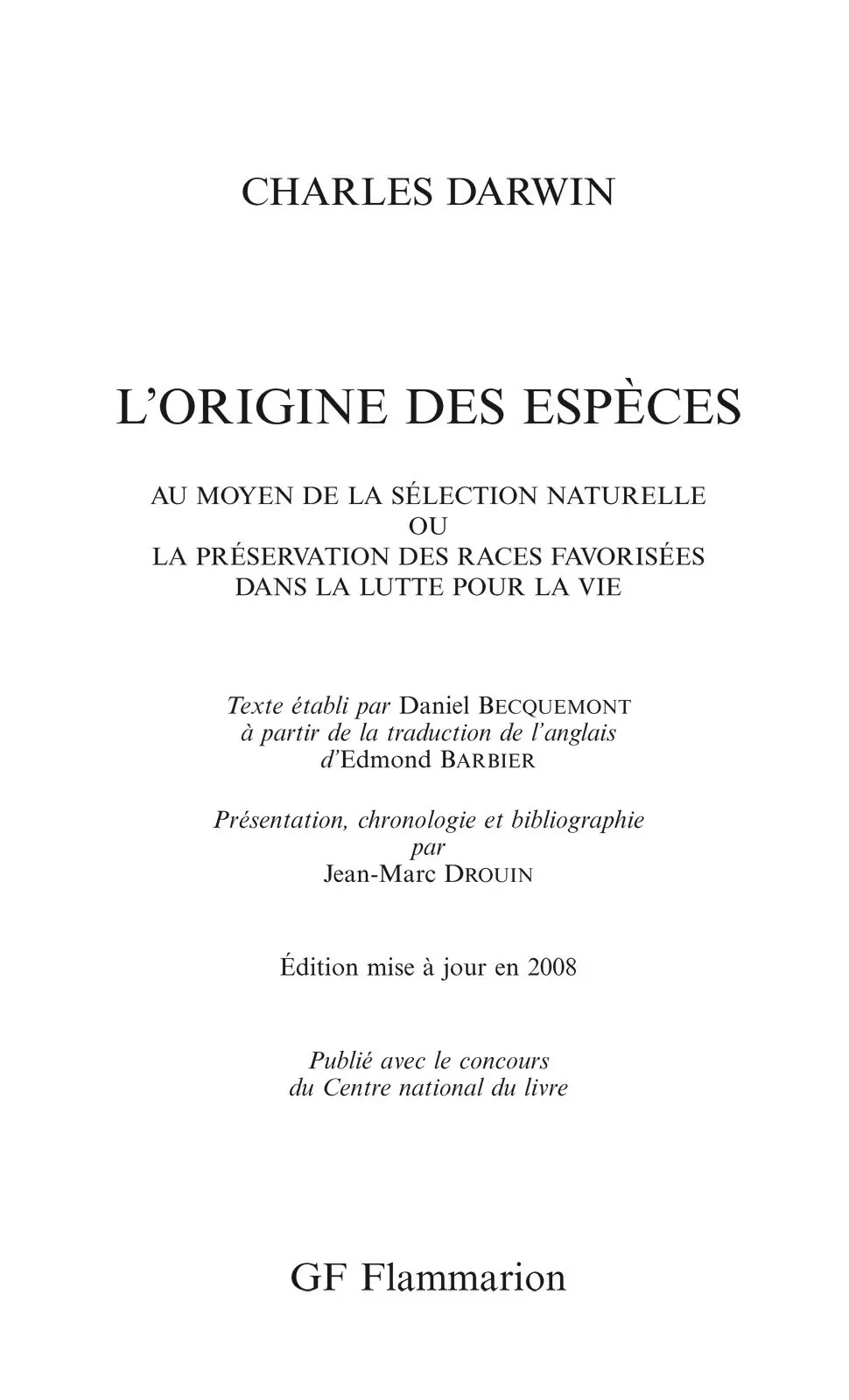

1 comment