La chouette aveugle
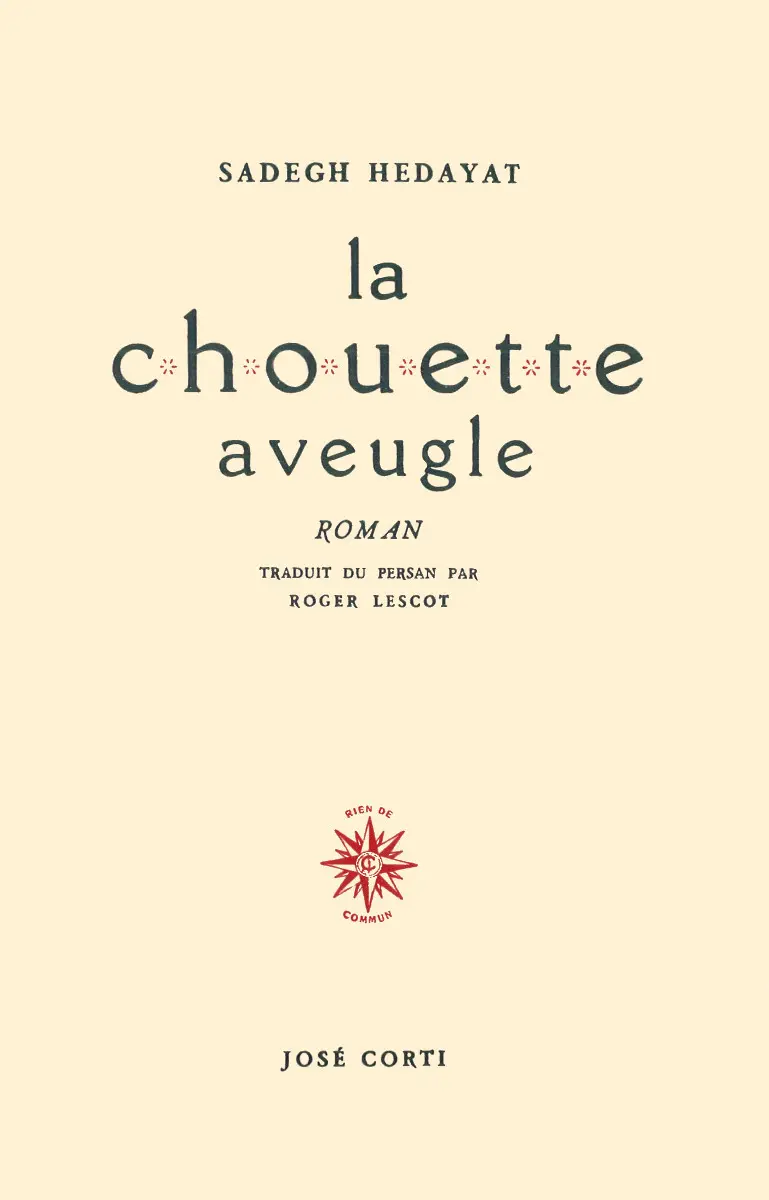
SADEGH HEDAYAT
LA
CHOUETTE
AVEUGLE
ROMAN
TRADUIT DU PERSAN PAR
ROGER LESCOT

JOSÉ CORTI
11, RUE DE MÉDICIS – PARIS-VIe
Le programme des parutions et le catalogue général
sont envoyés sur simple demande adressée à :
LIBRAIRIE JOSÉ CORTI, 11 RUE DE MÉDICIS, 75006 PARIS
LES DEUX DESSINS DE SADEGH HEDAYAT
QUI ORNENT CE VOLUME ILLUSTRAIENT
L’ÉDITION ORIGINALE PERSANE DE
« LA CHOUETTE AVEUGLE »
Copyright by Librairie José Corti, 1953.
Tous droits de reproduction, adaptation
et utilisation réservés.
No d’édition : 1402
ISBN 2-7143-0253-X
INTRODUCTION
LA littérature persane, vieille de plus de mille ans, offre cette rare particularité d’avoir, presque dès son apparition, atteint à une telle splendeur que son évolution ne pouvait que bientôt s’interrompre. Firdousi, Saadi, Hafiz et tant d’autres poètes, moins connus en Europe mais d’un égal génie, ont en effet porté d’emblée à leur perfection les genres qu’ils ont abordés. Dès la fin du XVe siècle, leurs émules, écrasés par un passé lourd de trop de gloire, se sont contentés de les imiter sans jamais parvenir à les égaler, ni oser s’écarter de la voie qu’ils leur avaient tracée.
C’est seulement de nos jours que, sous l’influence de l’Occident, certains écrivains iraniens ont senti le besoin de se libérer de cet héritage et d’acclimater dans leur pays un art plus moderne. Par une réaction naturelle contre l’esthétique jusque-là admise et dont toutes les faveurs allaient, par tradition, à la seule poésie, lyrique, didactique ou narrative, ils ont consacré le meilleur de leur effort à la création d’une littérature d’imagination en prose.
Quelques romans historiques, gauchement construits et d’un style pompeux, ont été, au début de ce siècle, les premiers fruits de ce renouveau. La jeune école ne devait, cependant, donner sa mesure que plus tard, avec des œuvres telles que les contes de Djemâlzâdeh, Yekî Boud, Yekî Naboud (« Il était une fois », 1921), Zîbâ, de Hedjâzi (1930), et surtout avec les recueils de nouvelles de Hedayat (« Enterré vivant », 1930 ; « Trois gouttes de sang », 1931 ; « Clair-obscur », 1932, etc.) et son roman, Bouf-é-Kour (« La Chouette aveugle », 1936).
Pour ne pas alourdir cet avant-propos, je me contenterai de renvoyer le lecteur curieux de cette Renaissance aux notes que j’ai données, en 1942, dans le Bulletin d’Études orientales de l’Institut français de Damas sur Le roman et la nouvelle dans la littérature iranienne contemporaine ; une large place est d’ailleurs réservée dans cet essai à l’œuvre de Hedayat. On lira aussi avec fruit la pénétrante étude que Vincent Monteil vient de consacrer à l’écrivain (V. Monteil, Sadeq Hedayat, Téhéran, 1952).
*
* *
Petit-fils du célèbre poète et critique Reza Qouli Khan Hedayat, Sadegh naquit à Téhéran le 17 février 1903. Il n’y a que peu à dire de sa vie extérieure. Son indépendance intellectuelle, sa modestie, sa pureté d’âme lui ont fait choisir en effet l’existence effacée et les souffrances d’un être d’élite qui se refuse aux compromis. Sa grande douceur de cœur, un esprit toujours prompt à saisir le ridicule des choses, son indulgence aussi pour ceux qu’il aimait, tempéraient seuls son mépris de ce monde.
Hedayat fit ses études en France, où il connut ses premières joies et ses premières douleurs, écrivit ses premières œuvres et, déjà, tenta le suicide. Ce furent ensuite de longues et mornes années à Téhéran, coupées, en 1935-1936, par un merveilleux voyage en Inde. Les changements apportés par la guerre éveillèrent un instant, chez l’écrivain l’espoir de transformations dans son pays et l’entraînèrent, mais pour peu de temps, dans le sillage du parti Toudeh. Cette expérience le laissa sur un profond dégoût.
Il n’aspirera plus dès lors qu’à l’évasion, et quand la gloire vient enfin à lui, il la repousse : ses amis doivent lui arracher ses manuscrits et en surveiller eux-mêmes l’impression. Dans les derniers jours de 1950, enfin, son grand rêve se réalise. Il est à Paris. Il s’y retrouve avec transport, en baise les pierres, comme il le confie à un intime. Mais il a fixé son destin. Quelques mois consacrés à des souvenirs, à d’anciennes affections ; un bref voyage à Hambourg ; il ne rentre en France que pour les préparatifs d’un plus grand départ. Il loue un modeste appartement rue Championnet, s’y enferme aussitôt et, le 9 avril, après avoir bouché soigneusement toutes les fuites d’air et mis tout en ordre, pour ceux qui le retrouveront, il ouvre le gaz. Édouard Saenger, un vieil ami qui l’avait aidé à emménager, l’a découvert étendu sur le carreau de la cuisine, dans une calme et presque souriante attitude, à côté des manuscrits brûlés de ses ultimes œuvres.
Le lendemain même, un de ceux qui l’aimaient le mieux, l’écrivain iranien Chahid Noura’i mourait d’une crise cardiaque dans un hôpital de Paris. Il ignorait son suicide. Puissent tous deux s’être rejoints dans un monde meilleur.
*
* *
Formé à la lecture des maîtres modernes de l’Europe (français surtout), mais également pénétré d’un profond amour pour le folklore et les traditions de sa patrie[1], S. Hedayat a cherché son inspiration auprès du peuple de l’Iran. Dans des pages pleines de spontanéité et de finesse, il s’est fait l’interprète des peines et des joies des petites gens de Téhéran ou de la province, paysans et tâcherons, qu’il savait comprendre mieux que personne. La plupart de ses nouvelles, pénétrantes études de mœurs, sont des chefs-d’œuvre qu’un Maupassant ne désavouerait pas.
Cependant, la passion avec laquelle l’écrivain s’est penché sur les religions de la Perse antique et sur les superstitions et les pratiques de magie populaire qui en dérivent, a éveillé aussi chez lui le goût de l’insolite et, bien souvent, il écarte les étroites barrières de la réalité, pour laisser le merveilleux envahir la vie de ses personnages : l’action d’un roman comme La Chouette aveugle se situe très loin de l’espace et du temps ordinaires.
Comme les plus grands poètes de sa race – on songe à Omar Khayyam, le seul, d’ailleurs, qu’il aimait – S. Hedayat est un pessimiste. C’est un regard désespéré qu’il promène sur le monde. Cet univers aux lois impénétrables, mais absurdes et cruelles, s’il entr’ouvre parfois devant nous ses cercles les plus fantastiques, loin de nous offrir alors la promesse d’une destinée meilleure au delà de l’existence terrestre, nous apparaît toujours baigné de la même sinistre lumière. Rien à espérer de cette vie, rien non plus d’une autre. Tel est le thème d’une aussi bouleversante nouvelle que La Citadelle maudite, qui nous montre les âmes des morts errant encore à la recherche de quelque certitude. Telle est aussi l’obsession que l’on retrouve à chaque ligne de La Chouette aveugle.
Le héros de cette histoire, rêveur isolé du reste de l’humanité par une sensibilité qu’exaspère l’abus des stupéfiants, poursuit sa sinistre aventure à travers deux avatars éloignés de plusieurs siècles. Les premières pages du livre nous le montrent soulevé vers l’idéal inaccessible que lui laisse entrevoir une apparition fugace comme un songe d’opium. Mais le charme se rompt ; brusquement replongé dans l’abîme du passé, le misérable assiste à la lointaine genèse des événements qu’il vient de vivre.
1 comment