Le Château
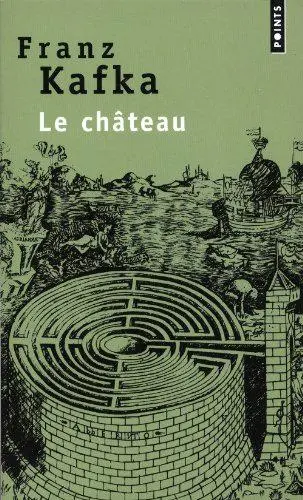
DU MÊME AUTEUR
Romans
L’Amérique
Le Procès
Le Château
Nouvelles
La Colonie pénitentiaire
Considération
Contemplation
Description d’un combat
La Métamorphose
La Muraille de Chine
Le Premier Grand Voyage en chemin de fer (Prague-Zurich)
Préparatifs de noce à la campagne
Tentation au village
Le Terrier
Un champion de jeûne
Un médecin de campagne
Le Verdict
Divers
Aphorismes
Les Aphorismes de Zürau
Cahier in-octavo (1916-1918)
Correspondance (1902-1924)
Journal
Journal intime
Lettres à Milena
Lettre à Max Brod – 1904-1924
Lettres à Olttla et à la famille
Lettre au père
Réflexions sur le péché, la souffrance,
l’espérance et le vrai chemin
Cette traduction a fait l’objet d’une première édition
chez Univers Poche en 1984.
TEXTE INTÉGRAL
TITRE ORIGINAL
Das Schloss
ISBN 978-2-7578-2741-3
© Éditions Points, 2011, pour la traduction française
Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo
Table des matières
Couverture
Collection
Copyright
Table des matières
Une patience sans issue
Le sens d’un roman
Le Château, son intrigue
Une marche sans issue
L’explication du Château
L’humour
Le Château dans l’œuvre de Kafka
Une histoire pour chacun
Comment lire Kafka
Le texte et les problèmes de traduction
Biographie de Franz Kafka
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Le secret d’amalia
La punition d’amalia
Adjurations
Les projets d’olga
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Une patience sans issue
Le sens d’un roman
« Les visions romanesques de Kafka nous parlent du monde sans mémoire, du monde après le temps historique », écrit Kundera dans « Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale » (Le Débat, n° 27, nov. 1983). Les grands romans de Kafka, en effet, qu’on le veuille ou non, parlent aussi de la grande mort de l’Europe, de l’éradication définitive et par l’intérieur de la pensée de liberté. Tout se passe comme si Kafka puis Musil ou Broch, Stefan Zweig ou Gombrowicz avaient d’avance senti déferler la barbarie sur l’Europe, sous sa forme hitlérienne d’abord, sous celle de l’occupation bureaucratique ensuite.
La dimension « politique » de l’œuvre de Kafka est en effet indéniable : mais le mot « politique » est à prendre dans un sens général comme description des structures de la société contemporaine, glissant peut-être vers une barbarie impalpable, incernable. Kundera dans cet article pose une question dont la formulation restitue déjà le déroulement même de ce dont parle Kafka : « La disparition du foyer culturel centre-européen fut certainement un des plus grands événements du siècle pour toute la civilisation occidentale. Je répète donc ma question : comment est-il possible qu’il soit resté inaperçu et innommé ? » (Le Débat, n° 27, p. 16). L’inaperçu et l’innommé sont au centre de tout ce qu’écrit Kafka ; il y a dans sa voix, comme un pressentiment, une anticipation ; non pas une vision, mais cette sensation indéterminée et étrange qui précède les grands anéantissements.
Ceci est une lecture immédiate, indispensable, mais qui pourtant ne va pas jusqu’au fond de ce qu’écrit Kafka. Il n’est pas suffisant de dire que son œuvre n’est que la description d’un certain fonctionnement social, d’un univers bureaucratique ; le génie de Kafka, c’est justement de se dérober à toute interprétation, d’aller toujours au-delà de ce qu’on en dit.
Le Château, son intrigue
Tout comme Le Procès, Le Château raconte une histoire extrêmement simple et cette fois particulièrement dérisoire : celle d’un arpenteur (mais l’est-il, même ?) convoqué dans un village pour un travail qu’il ne fera jamais. Il ne parviendra jamais au château qui domine le village, dont l’administration, à la fois lointaine et inaccessible, lui demeure insaisissable. L’Arpenteur K. – un homonyme de Josef K. du Procès – quitte les siens, fait un long voyage à travers la campagne enneigée et debout sur le pont de bois regarde le village devant lui, enfoui sous la neige.
Or, dès l’instant où ce pont est franchi, K. est pris dans un réseau inextricable de fausses manœuvres, d’incidents sans importance dans lesquels il s’enchevêtre et qui ne se déroulent qu’en sa présence ou de son fait. K. est là, pendant toute la durée du roman, d’un bout à l’autre, et cette présence de K. est précisément ce qui l’empêche d’accéder à ce qui sera bientôt son seul but : parvenir au château, être reconnu ou du moins être admis par lui ; mais K. est toujours sur son propre chemin : s’il n’existait pas, lui K., il y a longtemps qu’il aurait accédé au château1. C’est un peu la situation de l’enfant se demandant comment est l’arbre quand il ne le voit pas ; pour le savoir il n’a qu’une solution, se retourner et le regarder.
Avec une opiniâtreté aussi têtue que déplacée K. ne cesse de se tromper ; à chaque instant le moindre de ses propos est infirmé par la réalité ; tout ce qu’il fait débouche sur le vide mais il n’en persiste pas moins, incorrigible et pédant tout à la fois, comme s’il ne pouvait pas faire autrement. La femme de l’aubergiste ne le lui envoie pas dire : il est à la fois entêté et infantile (p. 92) ; au cours de cette conversation K., d’ailleurs, prend tout avec la superbe de l’ignorant et c’est l’aubergiste encore qui lui montrera, un peu plus loin, à quel point il ignore tout de la vie du village. Il trouve tout facile, mais dès le Ve chapitre le maire est obligé de démentir toutes ses conceptions, tous ses points de vue. Jamais K. ne progresse dans ses tentatives pour être admis au château, il est toujours au mauvais endroit au mauvais moment, mais si lui-même constate quelque erreur flagrante dans le fonctionnement de l’administration du château, celle-ci aussitôt s’avère à la fois insignifiante et impénétrable : à son arrivée, par exemple, (p. 28) le château d’abord confirme les soupçons du fils de l’intendant : K. n’est qu’un vagabond, pour rappeler aussitôt et dire que K. est bien arpenteur et qu’il a été engagé par le château ; par le maire du village (p. 105) il apprendra ensuite que son engagement n’est qu’une erreur administrative.
Une marche sans issue
Pourtant par une lettre remise par un haut fonctionnaire nommé Klamm, K. apprend que c’est de ce fonctionnaire qu’il dépend, mais cette lettre lui a été remise par un messager qui n’en est pas un et dont la belle apparence (p. 53) le trompe. Il n’a pas même été engagé. Il n’y a aucun travail d’arpentage à faire, il est là par erreur, comme le maire le lui démontre clairement (ch. V) ; sa présence est aussi inutile que dérisoire, il ne dérange même pas ; sa présence est tolérée, simplement ce qu’il voit n’est pas ce qui existe.
Un peu après son arrivée, K. attend ses aides qui le suivent, dit-il, avec les instruments de mesure (p. 29). Alors qu’il tente péniblement de se frayer un chemin dans la neige haute, deux personnages le dépassent et vont où il veut aller : ce sont non ses aides mais ceux que lui alloue le château qui le reconnaît donc comme arpenteur mais ne le charge d’aucun travail.
Ces deux aides, Arthur et Jeremias, sont des figures clés : ils sont comme la preuve manifeste du désarroi de K., ils figurent les obstacles qu’à chaque pas fait naître sa marche en avant.
1 comment