En
quittant la pièce, il se retourna pour regarder la photographie de Sybil
Merton, et fit serment que, quoi qu’il advienne, il ne l’instruirait jamais de
ce qu’il faisait pour elle, mais garderait toujours bien enfoui dans son cœur
le secret de son sacrifice.
En route pour le Buckingham Club, il s’arrêta chez un
fleuriste, et envoya à Sybil une magnifique corbeille de narcisses, aux
ravissants pétales blancs, et d’adonis éclatants ; dès qu’il fut arrivé au
club, il alla tout droit à la bibliothèque, sonna, et ordonna au garçon de lui
apporter un citron au soda et un livre de toxicologie. Il avait décidé qu’au
fond le poison était le meilleur moyen à adopter dans cette ennuyeuse affaire.
Tout ce qui ressemblait à la violence physique lui était extrêmement
désagréable, et d’ailleurs, il désirait vivement ne pas assassiner Lady
Clementina de quelque manière qui attirât l’attention publiquement, car il
détestait l’idée d’être fêté comme un personnage célèbre chez Lady Windermere,
ou de voir figurer son nom dans les entrefilets de vulgaires journaux mondains.
Il lui fallait songer aussi au père et à la mère de Sybil, qui étaient des gens
un peu vieux jeu, et qui pouvaient s’opposer au mariage s’il y avait quoi que
ce fût qui ressemblât à un scandale, bien qu’il fût convaincu que s’il leur
contait tous les détails de l’affaire, ils seraient les tout premiers à
approuver les motifs qui le poussaient à agir. Il avait donc toutes les raisons
du monde de porter son choix sur le poison. Ce procédé était sûr, efficace et
silencieux, et supprimait toute nécessité de scènes pénibles, pour lesquelles,
comme la plupart des Anglais, il avait une profonde répugnance.
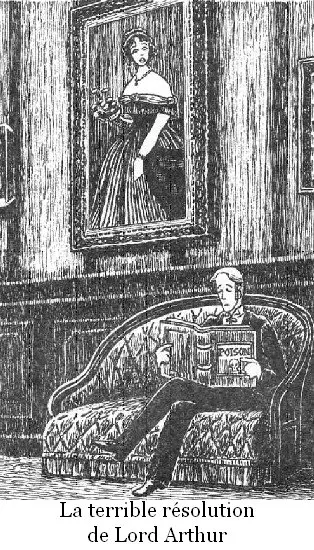
La science des poisons lui était, en revanche, totalement
étrangère, et comme le garçon parut totalement incapable de trouver, dans la
bibliothèque, autre chose que le Guide Ruff[27]
et le Bailey’s Magazine, il examina lui-même les rayons, et tomba
finalement sur une édition somptueusement reliée de la Pharmacopée, et
sur un exemplaire de la Toxicologie d’Erskine, annoté par Sir Matthew
Reid, président du Collège royal des Médecins, et l’un des membres les plus
anciens du Buckingham, où il avait été élu par erreur à la place d’un autre, –
contretemps qui mit le comité dans une telle fureur que, lorsque le vrai
candidat se présenta, on le blackboula à l’unanimité.
Lord Arthur fut considérablement intrigué par les termes
techniques employés dans l’un et l’autre de ces deux livres, et il commençait à
regretter de n’avoir pas étudié avec plus de soin ses classiques à Oxford,
lorsque, dans le second volume d’Erskine, il trouva un mémoire très intéressant
et complet sur les propriétés de l’aconitine, rédigé en un anglais assez intelligible.
Cela lui parut être exactement le poison qu’il lui fallait. Il était rapide, –
d’un effet quasi immédiat, – parfaitement indolore, et, pris sous la forme
d’une capsule de gélatine, ce qui était le mode indiqué par Sir Matthew,
n’était nullement désagréable au goût. Aussi inscrivit-il en note, sur sa
manchette, la quantité nécessaire pour une dose mortelle, puis il remit les
livres en place, et remonta lentement Saint-James’s Street, pour entrer chez
Pestle et Humbey, les grands pharmaciens. Mr. Pestle, qui servait toujours
personnellement l’aristocratie, fut fort surpris en prenant la commande, et sur
un ton très déférent, murmura quelques mots au sujet de la nécessité d’une
ordonnance. Toutefois, dès que Lord Arthur lui eut expliqué que c’était pour un
gros dogue norvégien dont il était obligé de se défaire, parce qu’il
manifestait les signes d’un commencement de rage, et avait déjà mordu deux fois
le cocher au mollet, le pharmacien se déclara parfaitement satisfait,
complimenta Lord Arthur sur ses connaissances remarquables en toxicologie, et fit
préparer immédiatement la dose nécessaire.
Lord Arthur mit la capsule dans une jolie petite bonbonnière
d’argent qu’il vit dans la vitrine d’un magasin de Bond Street, jeta la
déplaisante boîte à pilules de chez Pestle et Humbey, et se fit conduire
immédiatement chez Lady Clementina.
« Eh bien, Monsieur le mauvais sujet ! s’écria la
vieille dame, lorsqu’il pénétra dans la pièce, pourquoi n’êtes-vous pas venu me
voir, depuis tout ce temps ?
— Ma chère Lady Clem, je n’ai jamais un instant à moi,
dit Lord Arthur, en souriant.
— Vous voulez dire, sans doute, que vous passez toutes
vos journées avec Miss Sybil Merton, à acheter des chiffons et à dire des
fadaises ? Je ne comprends pas qu’on fasse un tel tapage à propos du
mariage. De mon temps, nous n’aurions jamais songé à roucouler en public, –
ni d’ailleurs dans l’intimité.
— Je vous assure que je n’ai pas vu Sybil depuis
vingt-quatre heures, Lady Clem. Pour autant que je puisse savoir, elle
appartient entièrement à ses modistes.
— Bien entendu ; c’est là la seule raison pour
laquelle vous venez voir un vieux laideron comme moi. Je m’étonne que vous ne
fassiez pas votre profit de tels avertissements, vous autres hommes. On a fait
des folies pour moi, et me voilà, pauvre rhumatisante, avec un faux chignon et
mon mauvais caractère. Ah ! si je n’avais pas cette chère Lady Jansen, qui
m’envoie tous les plus mauvais romans français[28]
qu’elle puisse trouver, je crois bien que je ne passerais pas la journée. Les
médecins ne servent absolument à rien, si ce n’est à vous soutirer des
honoraires. Ils ne sont même pas capables de guérir mes aigreurs.
— Je vous ai apporté pour cela un remède, Lady Clem,
dit gravement Lord Arthur. C’est une merveille, inventée par un Américain.
— Je n’aime pas les inventions américaines, Arthur.
Cela, j’en suis certaine. J’ai lu dernièrement quelques romans américains, et
ils étaient absolument vides de sens.
— Oh ! mais, en l’espèce, ce n’est pas le sens qui
manque, Lady Clem ! Je vous assure que c’est un remède parfait. Il faut me
promettre de l’essayer. »
Et Lord Arthur tira de sa poche la petite boîte et la lui
tendit.
« Enfin, la boîte est charmante, Arthur. C’est un
cadeau, sérieusement ? C’est très gentil de votre part. Et c’est là le
remède merveilleux ? On dirait un bonbon. Je vais le prendre tout de
suite.
— Grand Dieu ! Lady Clem, s’écria Lord Arthur, en
lui agrippant la main, surtout pas ! C’est un remède homéopathique, et si
vous le preniez sans avoir vos aigreurs, il pourrait vous faire énormément de
mal. Attendez d’avoir une crise, et prenez-le à ce moment-là. Vous serez
étonnée du résultat.
— Je voudrais le prendre maintenant, dit Lady
Clementina, levant à la lumière la petite capsule transparente avec sa bulle
flottante d’aconitine liquide. Je suis sûre que c’est délicieux. À vrai dire,
je déteste les médecins, mais j’adore les médicaments. Enfin, je le conserverai
jusqu’à ma prochaine crise.
— Et quand se produira-t-elle ? demanda Lord Arthur,
d’un ton de curiosité avide. Sera-ce bientôt ?
— Pas d’ici une semaine, j’espère. J’en ai eu une hier,
qui m’a fait passer un mauvais moment. Mais on ne sait jamais.
— Vous êtes donc certaine d’en avoir une avant la fin
du mois, Lady Clem ?
— Je le crains bien. Mais comme vous êtes compatissant,
aujourd’hui, Arthur ! Vraiment, Sybil vous a fait beaucoup de bien.
1 comment