En effet, si l’on compare la main aux instruments et outils artificiels de préhension et de manutention – pinces, râteaux, grappins, fourches et fourchettes – on constate que les éléments de ces derniers sont toujours parfaitement semblables entre eux, tandis que les doigts de la main possèdent chacun une personnalité qui reste énigmatique. L’esprit s’interroge et balbutie en face de cette diversité bizarre. Sa perplexité se traduit dans les justifications fantaisistes que suggèrent les noms mêmes attribués à chacun des doigts. Car s’il peut importer d’avoir un doigt qui pointe, qui désigne, qui dénonce – l’index –, il semble moins évident que l’auriculaire soit prévu pour se gratter le fond de l’oreille, et l’annulaire pour porter l’anneau conjugal. Quant à ce grand dadais de majeur, personne ne peut dire au juste pourquoi il dépasse en taille les autres doigts. Il n’y a que le pouce dont la faculté de s’opposer aux autres doigts semble si fondamentale et si nouvelle dans l’évolution des espèces, qu’on a voulu y voir la caractéristique même de l’être humain. Et dans une hyperbole admirable, Paul Valéry jette un pont entre cette opposabilité du pouce humain et la faculté – la conscience – que possède l’esprit humain de se penser lui-même.
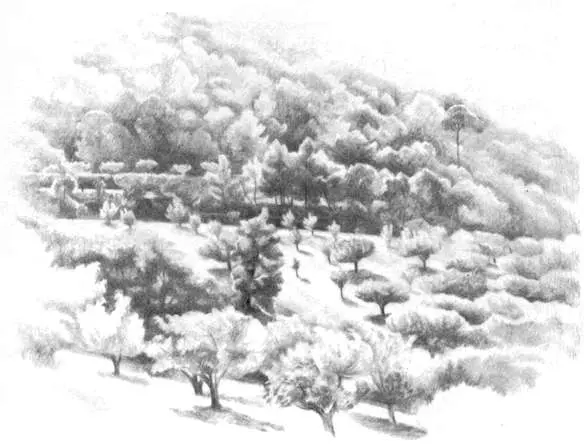
Saisons. Elles sont notre tourment et notre salut. Mauvaise saison. Pluie, froid, nuit et brouillard. Mais la terre labourée a un besoin vital d’une forte gelée pour demeurer fertile et saine…
Après un séjour au Gabon – où l’on baigne douze mois sur douze dans la même touffeur, où chaque arbre fleurit, fructifie et perd ses feuilles selon son rythme personnel et indépendamment des autres, où chaque jour de l’année le soleil se lève et se couche à la même heure – on apprécie au retour l’ordre de la grande horloge saisonnière, malgré ses rudesses.
Et puis il y a les fêtes. Paul Valéry se demandait quelles pouvaient être les chances de réussite du christianisme dans les pays où le pain et le vin sont ressentis comme des produits exotiques. C’est encore plus vrai des pays dont les saisons ne sont pas les nôtres.
25 mars, Annonciation. L’acte d’amour divin par lequel Marie est fécondée par l’Esprit se situe au seuil du printemps. Pâques, fête de la Résurrection de Jésus, prend place au moment où la vie sortant du tombeau de l’hiver, éclate à nos fenêtres. Fête-Dieu dans l’épanouissement floral de juin. Veillée de Noël aux nuits les plus longues de l’année, etc.

Mais c’est surtout la célébration de la beauté physique de Jésus qui tombe admirablement le 6 août. Ce jour-là, Jésus, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, gravit le mont Thabor, et là soudain il se révèle à eux dans toute sa divine splendeur. « Son visage resplendit comme le soleil », dit Matthieu. Plus discret et plus mystérieux, Luc écrit : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre. » La joie qui rayonne sur les témoins est si vive, que Pierre naïvement propose de dresser des tentes sur place et de rester là pour toujours. Combien de fois n’avons-nous pas rêvé en effet dans un musée, devant un chef-d’œuvre, de ne plus partir, de demeurer toujours dans le rayonnement chaleureux de la beauté ?
Or cette fête de la Transfiguration est célébrée le 6 août de l’an. On ne pouvait mieux choisir. Qu’est-ce donc que le 6 août ? C’est le sommet de l’été. Après cette date il ne peut que ravaler. La beauté a atteint son zénith. Tout le monde est en vacances. On est arrivé depuis une semaine maintenant. Les corps bronzés sentent bon le sel et le sable. La nudité a repris ses droits. C’est la grande fête de la chair réhabilitée, arrachée aux ténèbres paléotestamentaires des vêtements et rendue à l’innocence adamique de l’air et du soleil.
Dépôt légal : janvier 1984
ISBN 2-07-070058-51.
.
1 comment