Marie Stuart
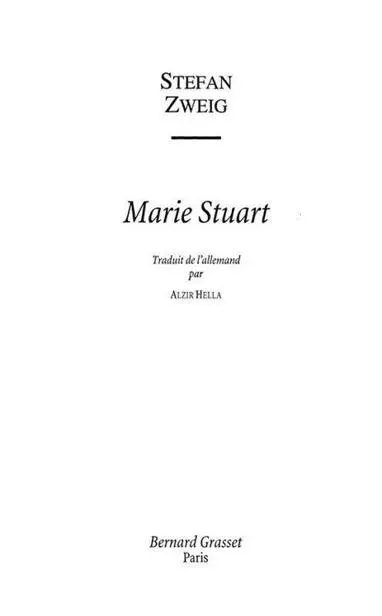
TABLE
Dramatis personœ.
Préface
Reine au berceau
Jeunesse en France
Reine, veuve et reine encore
Retour en Ecosse
Premier avertissement
Grand marché matrimonial politique
Second mariage
La nuit dramatique de Holyrood
Les félons trahis
Effroyable complication
Tragédie d’une passion
La voie du meurtre
Quos deus perdere vult
La voie sans issue
La destitution
Adieu à la liberté
Une machination se trame
Le filet se resserre
Les années dans l’ombre
La guerre au couteau
Il faut en finir
Elisabeth contre Elisabeth
« En ma fin est mon commencement »
Epilogue
L’édition originale de cet ouvrage a été publiée par Insel-Verlag, à Leipzig, en 1935, sous le titre :
MARIE STUART
ISSN 0756-7170
© Williams Verlag, Zürich et Atrium Press, Londres, 1976.
© Éditions Grasset & Fasquelle, 1936, pour la traduction française.
978-2-246-80203-7
DU MEME AUTEUR
Brûlant secret
Castellion contre Calvin
Le Chandelier enterré
Érasme
Joseph Fouché
Magellan
Marie-Antoinette
La Peur
La Pitié dangereuse
Souvenirs et rencontres
Trois maîtres (Dostoïevski-Balzac-Dickens)
Un caprice de Bonaparte
Correspondance, 1897-1919
Correspondance, 1920-1931
Correspondance, 1932-1942
Le voyage dans le passé
Un soupçon légitime
Les grandes vies
Stefan Zweig / Marie Stuart
Stefan Zweig est né à Vienne, le 28 novembre 1881, dans une famille d’industriels appartenant à la grande bourgeoisie israélite. Avec Hugo von Hofmannsthal, avec Robert Musil, avec Arthur Schnitzler, il est une des figures dominantes de cette génération prodigieuse de la littérature autrichienne dont l’épanouissement coïncidera avec la chute du vieil empire des Habsbourg.
Sa situation de fortune le délivrant des préoccupations matérielles, c’est la seule curiosité qui guide ses études. Curieux, Zweig l’est à la fois de philosophie et de belles lettres, d’histoire et de voyages. Jeune homme, il parcourt l’Europe à la découverte des littératures étrangères. Il se lie avec Verhaeren dont il traduit les poèmes en allemand, parvenant avec un rare bonheur à en restituer tout le lyrisme. Plus tard, il donnera aussi de remarquables versions de Verlaine et de Rimbaud. En 1901, à peine âgé de vingt ans, il fait paraître son premier recueil de vers, Cordes d’argent, suivi, en 1907, par les Guirlandes précoces. Son inspiration éminemment éclectique l’amène ensuite à se consacrer au théâtre. Il compose deux drames, Tersites (1907) et la Maison au bord de la mer (1911).
A cet humaniste accompli, à ce grand voyageur féru d’échanges intellectuels au-delà des nationalités, la guerre fait l’effet d’un traumatisme. Immédiatement, Zweig comprend qu’elle consomme la fin d’un monde ; c’est la signification qu’il lui donne dans tous les romans où il la met en scène. Ses convictions pacifistes s’expriment dans deux pièces de théâtre, Jérémie (1916) et l’Agneau du pauvre (1930). On peut regretter que ses œuvres intéressantes aient été éclipsées par Volpone (1927), qui demeure le plus grand succès théâtral de Zweig.
En 1919, Zweig s’installe à Salzbourg où il restera quinze ans. C’est là qu’il écrit quelques-unes des nouvelles (parfois fort longues) qui lui apportent une célébrité mondiale : Amok (1922), la Confusion des sentiments (1926), les Heures étoilées de l’humanité (1928), Vingt-Quatre Heures de la vie d’une femme (1934). Avec la nouvelle, Zweig trouve sa veine la plus originale et s’affirme bientôt comme le peintre minutieux et magistral des drames de l’être intime. Le destin joue un grand rôle dans ses récits, mais le destin selon Zweig n’est pas une entité surnaturelle. A la lumière des enseignements de Freud (auquel il consacra un essai, et une partie de la Guérison par l’esprit, 1931) qui marquent profondément sa démarche romanesque, Zweig s’applique à révéler, dans le processus de fatalité dont ses héros et ses héroïnes sont victimes, la part qui revient au déterminisme de l’inconscient.
Parallèlement, il fait œuvre de biographe et d’essayiste avec, en 1919, Trois maîtres (Dostoïevski, Balzac, Dickens), en 1925 la Lutte avec le démon (Kleist, Hölderlin, Nietzsche). Lorsqu’il interroge la vie de ces écrivains, il mêle librement le portrait clinique à la biographie et, par l’analyse des tourments et des motivations intérieurs, tente d’éclairer les mécanismes de la création. Son goût pour l’histoire lui inspire encore des vies de Fouché (son chef-d’œuvre biographique), de Marie-Antoinette, de Magellan. Plus que par le rôle historique qu’ont joué ces personnages, on devine Zweig séduit par leurs figures pathétiques ou leurs destins d’exception. C’est en romancier qu’il les décrit et les fait vivre, leur restituant cette dimension de vérité intime dont l’histoire qui se fonde sur les seuls faits ne saurait complètement rendre compte.
En 1934, Zweig vient s’établir à Londres pour y poursuivre les recherches préparatoires à sa vie de Marie Stuart. Son voyage n’a aucun motif politique, mais bientôt l’invasion de l’Autriche par les troupes de Hitler et sa réunion à l’Allemagne nazie dissuadent l’écrivain de rentrer dans son pays. C’est durant cet exil qu’il écrit Brûlant Secret (1938) et son unique roman, la Pitié dangereuse (1939). En 1940, il devient sujet britannique.
Au début de la guerre, en compagnie de sa seconde femme, il quitte l’Angleterre pour les Etats-Unis et réside quelques mois dans la banlieue de New York. Puis, en août 1941, il décide de s’installer au Brésil. C’est à Petrópolis qu’il achève de rédiger son autobiographie, le Monde d’hier, portrait de l’Europe d’avant 1914, vue avec le regard enchanté de la mémoire.
Profondément affectés par la guerre et désespérant de l’avenir du monde, Zweig et sa jeune femme décident de se donner la mort. Ils s’empoisonnent ensemble le 23 février 1942.
Née en 1542 et reine d’Ecosse six jours plus tard à la mort de son père, reine de France à dix-sept ans après son mariage avec François II, veuve l’année suivante, mariée d’amour à lord Darnley, maîtresse du comte de Bothwell qui tuera... Darnley, réfugiée auprès d’Elisabeth Ire, reine d’Angleterre, qui la gardera captive pendant vingt ans, décapitée en 1587 pour être tombée dans le piège d’une conspiration contre cette même Elisabeth : Marie Stuart – criminelle pour les uns, martyre pour les autres – est l’une des figures les plus romanesques et les plus tragiques de l’Histoire, l’une des plus intrigantes aussi... Autant dire une provocation pour Stefan Zweig – « le mystère exerce une action créatrice » – qui lui consacrera cette biographie en 1935.
L’auteur brasse une masse énorme de récits, de documents ; confronté à la versatilité des témoignages, aux nombreux mensonges et fantasmes nourris par l’héroïne, il les filtre, les tamise, dans une langue, dans une narration magnifiques, au service de la nuance, du double fond. Au centre d’inévitables zones obscures, Zweig soumet la mythologie Stuart à son intuition, à sa connaissance du cœur humain. C’est, on le sait, un immense psychologue, aussi rigoureux qu’intuitif.
1 comment