Nietzsche
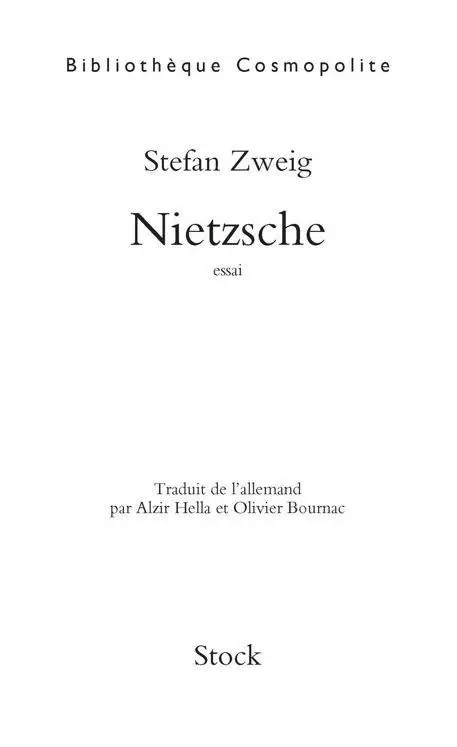
Table des matières
Couverture
Page de titre
Table des matières
Page de copyright
DU MÊME AUTEUR AUX ÉDITIONS STOCK
Dédicace
1 - Tragédie sans personnages
2 - Double portrait
3 - Apologie de la maladie
4 - Le don Juan de la connaissance
5 - Passion de la sincérité
6 - Marche progressive vers soi-même
7 - Découverte du Sud
8 - Le refuge de la musique
9 - La septième solitude
10 - La danse au-dessus de l'abîme
11 - L'éducateur de la liberté
Traduit de l'allemand
par Alzir Hella et Olivier Bournac
Tous droits réservés pour tous pays.
© 1930, 1978, 1993, 1996, 1999, 2004, Éditions Stock pour la traduction française.
978-2-234-07510-8
DU MÊME AUTEUR
AUX ÉDITIONS STOCK
Amok
La confusion des sentiments
Le joueur d'échecs
Vingt-quatre heures de la vie d'une femme
CHEZ
D'AUTRES
ÉDITEURS
Amerizo
Amour d'Erika Ewald
Balzac, Le roman de sa vie
Brésil, terre d'avenir
Brûlant secret
Clarissa
Le combat avec le démon
Journaux 1912-1940
Voyages
Bibliothèque Cosmopolite
Je fais cas d'un philosophe dans la mesure où il est capable de fournir un exemple.
Considérations inactuelles
1
Tragédie
sans personnages
Récolter la plus grande jouissance de l'existence, c'est vivre dangereusement.
La tragédie de Friedrich Nietzsche est un drame solitaire : aucun autre personnage n'est présent sur la courte scène de sa vie. Au cours des actes de cette tragédie qui se ruent comme une avalanche, le lutteur isolé se tient seul sous le ciel orageux de son propre destin ; personne auprès de lui, personne pour s'opposer à lui, aucune femme pour adoucir de sa tendre présence l'atmosphère tendue. Tout mouvement provient de lui et il en est le seul témoin : les rares figures qui se risquent au début dans son ombre accompagnent seulement d'un geste muet d'effroi et de surprise son héroïque entreprise et s'écartent peu à peu devant lui comme devant un péril. Pas un seul humain n'ose se risquer à entrer pleinement dans le cercle intérieur de cette destinée ; Nietzsche parle toujours, lutte toujours, souffre toujours pour lui seul. Il n'adresse la parole à personne et personne ne lui répond. Bien pire, personne ne lui prête attention.
Il n'y a pas d'êtres humains, pas de partenaires, pas d'auditeurs dans la tragédie — d'un héroïsme unique — de Friedrich Nietzsche, mais il n'y a pas non plus de scène proprement dite, de paysage, de décors, de costumes ; elle se joue, pour ainsi dire, dans l'espace vide de l'idée. Bâle, Naumbourg, Sorrente, Sils-Maria, Gênes, ces noms ne sont pas ceux des véritables habitats de Nietzsche, mais simplement des pierres milliaires le long d'un chemin parcouru dans un vol brûlant — simplement de froides coulisses, des couleurs sans langage ! En vérité, le décor de cette tragédie reste toujours le même : l'isolement, la solitude, cette atroce solitude sans parole et sans réponse que la pensée nietzschéenne porte autour d'elle et en elle comme une impénétrable cloche de verre, une solitude sans fleurs ni lumière, sans musique, sans animaux, sans hommes, une solitude privée de Dieu même, la solitude pétrifiée et éteinte d'un monde primitif en dehors du temps. Si le vide et la tristesse font horreur, épouvantent et en même temps paraissent tellement grotesques, c'est que — ironie incroyable — ce glacier, ce désert de solitude se tient spirituellement au milieu d'un pays américanisé de soixante-dix millions d'habitants, en plein milieu de l'Allemagne nouvelle toute vibrante et retentissante de chemins de fer et de télégraphes, de cris et de tumultes, au centre d'une culture dont, par ailleurs, la curiosité est maladive, qui jette tous les ans dans le monde quarante mille volumes, qui étudie chaque jour mille problèmes dans cent universités, qui, chaque jour, joue la tragédie dans des centaines de théâtres et qui, cependant, ne sait rien, ne devine rien et ne sent rien de ce formidable drame de l'esprit qui se déroule dans sa propre ambiance, dans son cercle le plus intime.
Car, précisément, à ses moments les plus grandioses, la tragédie de Friedrich Nietzsche n'a plus un spectateur, un auditeur, un seul témoin dans le monde allemand. Au début, tant qu'il parle du haut de sa chaire de professeur et que la lumière de Wagner le met en vue, son discours suscite encore un peu d'attention, mais plus il descend au fond de lui-même, plus il plonge dans la profondeur du temps, et moins il rencontre de résonance. L'un après l'autre, les amis, les étrangers se lèvent, effarouchés, pendant son monologue héroïque, effrayés par les transformations toujours plus sauvages, par les extases toujours plus ardentes du philosophe et ils le laissent affreusement seul sur la scène de son destin. Peu à peu l'acteur tragique s'inquiète de parler absolument dans le vide ; il élève la voix toujours davantage, il crie et gesticule toujours plus pour faire naître un écho ou tout au moins une contradiction. Il invente, pour la marier à sa parole, une musique — une musique jaillissante, enivrante, dionysiaque —, mais personne n'écoute plus. Il a recours à des arlequinades, à une gaieté forcée, stridente et perçante ; il fait faire à ses phrases des cabrioles et les garnit de lazzi, simplement pour attirer, par ses amusements artificiels, des auditeurs à son évangile d'un sérieux terrible, mais aucune main ne bouge pour l'applaudir. Enfin il invente une danse, une danse des épées et, meurtri, déchiré, sanglant, il exerce devant le public son nouvel art mortel, mais personne ne devine le sens de ses plaisanteries criardes, ni la passion blessée à mort qu'il y a dans cette légèreté affectée. Sans auditeurs et sans écho s'achève devant des bancs vides le drame le plus extraordinaire de l'esprit qui ait été offert à notre siècle agité. Personne ne tourne, même négligemment, son regard vers lui, lorsque la toupie de ses pensées vibrant sur une pointe d'acier bondit pour la dernière fois magnifiquement et tombe enfin, épuisée, sur le sol — « morte d'immortalité ».
Cet état d'isolement avec soi-même, cette façon d'être seul en face de soi-même, est le sens le plus profond, la détresse sacrée et sans exemple de cette tragédie que fut la vie de Friedrich Nietzsche : jamais une plénitude si grandiose de l'esprit, une orgie si extrême du sentiment ne furent placées en face d'un vide du monde si énorme, en face d'un silence si métalliquement impénétrable. Il n'a même pas eu la faveur de trouver des adversaires importants ; ainsi la plus puissante volonté de pensée, « renfermée en elle-même et se creusant elle-même », est obligée de chercher une réponse et une résistance dans sa propre poitrine, dans sa propre âme tragique. Ce n'est pas au monde, mais aux lambeaux saignants de sa propre peau que cet esprit rendu furieux par le destin arrache, comme Héraclès, sa tunique de Nessus, cette ardeur dévorante, pour être nu en face de la vérité suprême, en face de lui-même. Mais quel frisson glacial autour de cette nudité, quel silence autour de ce cri sans précédent de l'esprit, quel ciel épouvantable plein de nuages et d'éclairs, au-dessus du « meurtrier de la divinité » qui, maintenant qu'aucun adversaire ne se porte à sa rencontre et que lui-même n'en trouve plus, s'attaque à son propre être — « connaisseur de soi-même, bourreau de soi-même, sans pitié ». Poussé par son démon par-delà le temps et le monde, par-delà même la limite la plus extrême de son être,
Secoué, hélas ! par des fièvres inconnues,
Tremblant devant les flèches acérées et glacées de [la froidure,
Chassé par toi, ô pensée !
Indicible ! Sombre ! Effrayant !
il recule parfois en frissonnant, avec un regard d'épouvante sans nom, lorsqu'il reconnaît à quel point sa vie l'a précipité par-delà tout ce qui est vivant et tout ce qui a été. Mais un élan si puissant ne peut plus reculer : avec une pleine confiance et en même temps dans l'extase la plus extrême de l'enivrement de soi-même, il accomplit la destinée que son cher Hölderlin a préfigurée pour lui — sa destinée d'Empédocle.
Un héroïque paysage sans ciel, un jeu gigantesque sans spectateurs, le silence, un silence toujours plus intense autour du cri le plus terrible de la solitude de l'esprit, telle est la tragédie de Friedrich Nietzsche : il faudrait l'abominer comme une des nombreuses cruautés insensées de la nature, s'il ne l'avait pas lui-même acceptée extatiquement et s'il n'en avait pas choisi et aimé la dureté unique, à cause même de ce caractère unique. Car volontairement, en toute lucidité, renonçant à une existence assurée, il s'est construit cette « vie particulière » avec le plus profond instinct tragique et il a défié les dieux avec un courage sans exemple, pour « éprouver par lui-même le plus haut degré de péril dans lequel un homme puisse vivre ». « Xαιρετε δαιμονες ! — Salut à vous, démons ! »
C'est en poussant ce cri enjoué de l'hybris qu'une fois, par une joyeuse nuit, à la manière des étudiants, Nietzsche et ses amis philosophes évoquent les Puissances : à l'heure où rôdent les Esprits, ils versent par la fenêtre le rouge vin de leurs verres pleins dans une rue endormie de la ville de Bâle — comme une libation aux Invisibles. Ce n'est là qu'une plaisanterie de l'imagination que taquine un pressentiment plus profond : mais les démons entendent cet appel et poursuivent celui qui les a défiés, jusqu'à ce que le jeu d'une nuit devienne la tragédie grandiose d'une destinée.
Cependant, jamais Nietzsche ne se dérobe aux exigences monstrueuses par lesquelles il se sent irrésistiblement saisi et entraîné : plus le marteau le frappe durement, plus résonne clair le bloc d'airain de sa volonté. Et sur cette enclume portée au rouge par le feu de la puissance, se forge, toujours plus durement, à chaque coup redoublé, la formule qui cuirasse ensuite de bronze son esprit, la « formule de la grandeur de l'homme », amor fati : ne vouloir changer aucun fait dans le passé, dans l'avenir, éternellement ; non seulement supporter la nécessité, encore moins la dissimuler, mais l'aimer. Ce chant d'amour fervent adressé aux Puissances couvre comme un dithyrambe le cri de sa propre douleur : jeté à terre, vaincu par le silence du monde, dévoré par lui-même, rongé par l'amertume de la souffrance, il ne lève jamais les mains pour demander au destin de le laisser enfin en paix. Au contraire, il réclame encore une détresse plus grande, une solitude plus profonde, une souffrance plus complète, l'épreuve la plus rigoureuse pour son endurance ; s'il lève les mains ce n'est pas pour se dérober, mais pour lancer la magnifique prière du héros : « Ô volonté de mon âme, que j'appelle destin, toi qui es en moi, toi qui es au-dessus de moi, conserve-moi et préserve-moi pour un grand destin. »
Or, celui qui sait prier avec tant de grandeur est toujours exaucé.
2
Double portrait
Le pathos de l'attitude n'appartient pas à la grandeur ; qui a besoin d'attitude est faux... Méfions-nous de tous les hommes pittoresques !
Image pathétique du héros. Voici comment le campe le mensonge marmoréen, la légende pittoresque : une tête héroïque hautainement dressée, un haut front voûté, raviné par de sombres pensées, la vague des cheveux pesant puissamment sur une nuque forte et saillante. Sous les paupières en broussaille luit un regard de faucon ; chaque muscle de ce visage puissant est tendu de volonté, de santé et de vigueur. La moustache à la Vercingétorix tombant virilement sur une bouche âpre et sur le menton proéminent montre le guerrier barbare, et involontairement on complète cette tête de lion robustement musclée par un corps de Viking germanique s'avançant à grands pas, avec le glaive de la victoire, le cor de chasse et la lance.
1 comment