Paradoxe sur le comédien
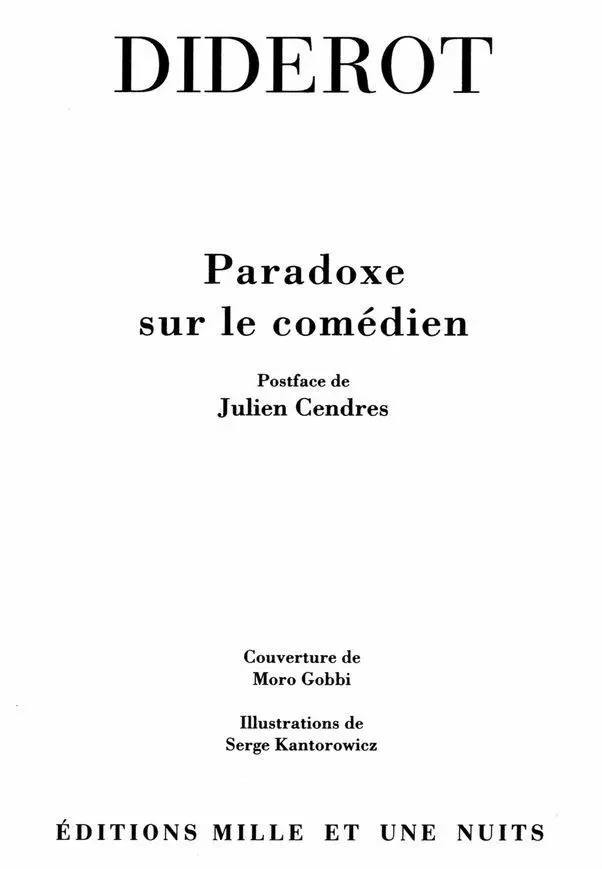
Table des Matières
Page de Titre
Table des Matières
Page de Copyright
Paradoxe sur le comédien
Denis Diderot, ou le paradoxe pour principe
Repères bibliographiques
© Éditions Mille et une nuits, avril 1999.
978-2-755-50352-4
Postface de
Couverture de
Moro Gobbi
Illustrations de
Serge Kantorowicz
Notre adresse internet : www. 1001 nuits. com

Vie de Denis Diderot
5 octobre 1713. Naissance de Denis Diderot à Langres, d'un père coutelier de son état.
1723-1727. Études chez les jésuites de Langres. Il reçoit la tonsure le 22 août 1726.
1728. Poursuite de ses études à Paris.
1741. Il rencontre Antoinette Champion, marchande de lingerie.
1742. Il travaille à la traduction de l'Histoire de la Grèce de Temple Stanyan. Première rencontre avec Jean-Jacques Rousseau.
1743. Il part à Langres et annonce à sa famille son intention d'épouser Antoinette Champion. Son père le fait enfermer dans un monastère, d'où il s'échappe pour revenir à Paris. Au mois de novembre, il se marie clandestinement.
1744. Il est engagé comme traducteur pour le Dictionnaire universel de médecine et de chirurgie de Robert James.
1745. Il publie une traduction libre de l'Essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury.
1746. Il rédige sa première œuvre, les Pensées philosophiques. Condamnation de l'ouvrage par le parlement de Paris.
1747. Les libraires associés confient à Diderot et à d'Alembert la direction de L'Encyclopédie.
1748. Il publie anonymement Les Bijoux indiscrets.
1749. Publication de la Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Il est emprisonné à Vincennes pour cet écrit, de juillet à octobre.
1751. Parution du tome I de L'Encyclopédie.
1753. Naissance de sa fille Marie-Angélique.
1755. Début de la correspondance avec Sophie Volland qui sera son grand amour, malgré quelques autres passions.
1756. Séjour à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, avec Rousseau.
1757. Diderot publie Le Fils naturel, qui entraîne la rupture avec Rousseau.
1758. Il publie Le Père de famille, autre pièce de théâtre créée en 1761.
1759. Condamnation de L'Encyclopédie par le Parlement. Mort du père de Diderot. Il rédige son premier Salon.
1760. Il commence à écrire La Religieuse.
1762. Il entreprend la rédaction du Neveu de Rameau.
1763. Il écrit la Lettre historique et politique sur le commerce de la librairie.
1765. L'impératrice de Russie Catherine II lui achète sa bibliothèque. Il commence Jacques le Fataliste et écrit l'Essai sur la peinture.
1766. Mise en vente des dix-sept volumes de L'Encyclopédie.
1767. Il est élu membre de l'Académie des arts de Saint-Pétersbourg.
1769. Il écrit Le Rêve de d'Alembert. Reprise du Père de famille. Liaison avec Mme de Meaux.
1771. Première rédaction de Jacques le Fataliste.
1773. Publication du Supplément au Voyage de Bougainville. Diderot voyage en Allemagne et en Russie, jusqu'à Saint-Pétersbourg.
1774. Retour en France, après un séjour en Hollande.
1778. Publication de Jacques le Fataliste. Mort de Voltaire (30 mai), de Rousseau (2 juillet).
1780. Publication de La Religieuse.
1784. Mort de Sophie Volland (22 février). Mort de Diderot (31 juillet).
1796. Première publication de Jacques le Fataliste.
1830. Première publication du Paradoxe sur le comédien.
1875-1876. Publication des Œuvres complètes de Diderot aux éditions Garnier.
DIDEROT
n° 233

Texte intégral
Paradoxe sur le comédien
PREMIER INTERLOCUTEUR
N'en parlons plus.
SECOND INTERLOCUTEUR
Pourquoi ?
LE PREMIER
C'est l'ouvrage de votre ami.
LE SECOND
Qu'importe ?
LE PREMIER
Beaucoup. À quoi bon vous mettre dans l'alternative de mépriser ou son talent, ou mon jugement, et de rabattre de la bonne opinion que vous avez de lui ou de celle que vous avez de moi ?
LE SECOND
Cela n'arrivera pas; et quand cela arriverait, mon amitié pour tous les deux, fondée sur des qualités plus essentielles, n'en souffrirait pas.
LE PREMIER
Peut-être.
LE SECOND
J'en suis sûr. Savez-vous à qui vous ressemblez dans ce moment ? À un auteur de ma connaissance
qui suppliait à genoux une femme à laquelle il était attaché, de ne pas assister à la première représentation d'une de ses pièces.
LE PREMIER
Votre auteur était modeste et prudent.
LE SECOND
Il craignait que le sentiment tendre qu'on avait pour lui ne tînt au cas que l'on faisait de son mérite littéraire.
LE PREMIER
Cela se pourrait.
LE SECOND
Qu'une chute publique ne le dégradât un peu aux yeux de sa maîtresse.
LE PREMIER
Que moins estimé, il ne fût moins aimé. Et cela vous paraît ridicule ?
LE SECOND
C'est ainsi qu'on en jugea. La loge fut louée, et il eut le plus grand succès : et Dieu sait comme il fut embrassé, fêté, caressé.
LE PREMIER
Il l'eût été bien davantage après la pièce sifflée.
LE SECOND
Je n'en doute pas.
LE PREMIER
Et je persiste dans mon avis.
LE SECOND
Persistez, j'y consens; mais songez que je ne suis
pas une femme, et qu'il faut, s'il vous plaît, que vous vous expliquiez.
LE PREMIER
Absolument ?
LE SECOND
Absolument.
LE PREMIER
Il me serait plus aisé de me taire que de déguiser ma pensée.
LE SECOND
Je le crois.
LE PREMIER
Je serai sévère.
LE SECOND
C'est ce que mon ami exigerait de vous.
LE PREMIER
Eh bien, puisqu'il faut vous le dire, son ouvrage, écrit d'un style tourmenté, obscur, entortillé, boursouflé, est plein d'idées communes. Au sortir de cette lecture, un grand comédien n'en sera pas meilleur, et un pauvre acteur n'en sera pas moins mauvais. C'est à la nature à donner les qualités de la personne, la figure, la voix, le jugement, la finesse. C'est à l'étude des grands modèles, à la connaissance du cœur humain, à l'usage du monde, au travail assidu, à l'expérience, et à l'habitude du théâtre, à perfectionner le don de nature. Le comédien imitateur peut arriver au point de rendre tout passablement ; il n'y a rien ni à louer, ni à reprendre dans son jeu.
LE SECOND
Ou tout est à reprendre.
LE PREMIER
Comme vous voudrez. Le comédien de nature est souvent détestable, quelquefois excellent. En quelque genre que ce soit, méfiez-vous d'une médiocrité soutenue. Avec quelque rigueur qu'un débutant soit traité, il est facile de pressentir ses succès à venir. Les huées n'étouffent que les ineptes. Et comment la nature sans l'art formerait-elle un grand comédien, puisque rien ne se passe exactement sur la scène comme en nature, et que les poèmes dramatiques sont tous composés d'après un certain système de principes ? Et comment un rôle serait-il joué de la même manière par deux acteurs différents, puisque dans l'écrivain le plus clair, le plus précis, le plus énergique, les mots ne sont et ne peuvent être que des signes approchés d'une pensée, d'un sentiment, d'une idée; signes dont le mouvement, le geste, le ton, le visage, les yeux, la circonstance donnée, complètent la valeur ? Lorsque vous avez entendu ces mots :
« [...] Que fait là votre main ?
– Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. » 1
Que savez-vous ? Rien. Pesez bien ce qui suit, et concevez combien il est fréquent et facile à deux interlocuteurs, en employant les mêmes expressions, d'avoir pensé et de dire des choses tout à fait différentes. L'exemple que je vous en vais donner est une espèce de prodige; c'est l'ouvrage même de votre ami. Demandez à un comédien français ce qu'il en pense, et il conviendra
que tout en est vrai. Faites la même question à un comédien anglais, et il vous jurera by God, qu'il n'y a pas une phrase à changer, et que c'est le pur évangile de la scène.
1 comment