Sanditon

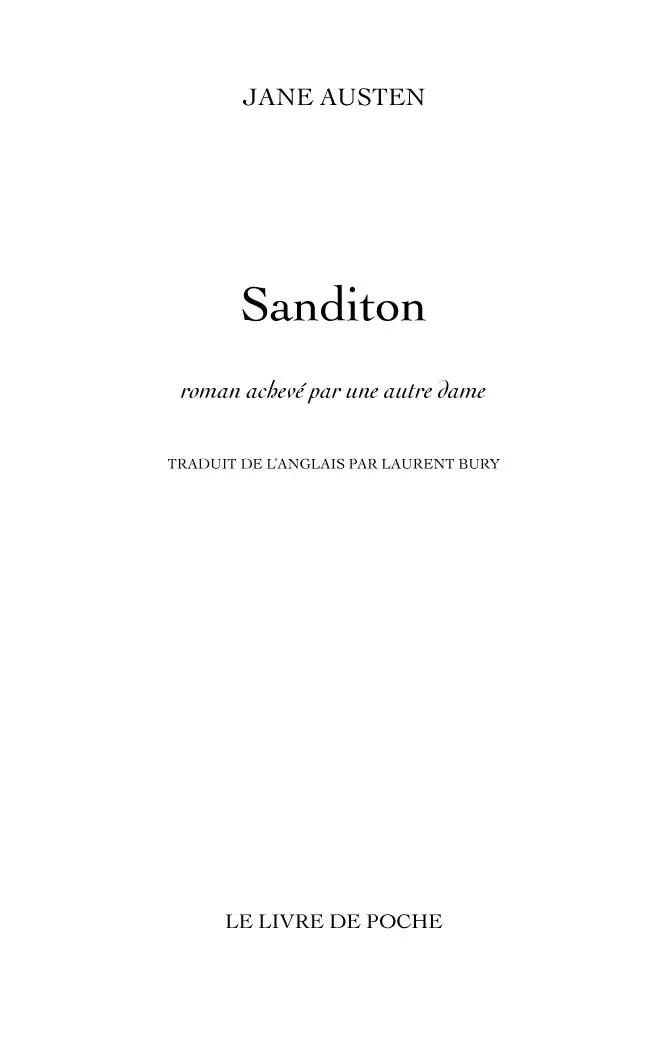
1
Un monsieur et une dame partis de Tunbridge se dirigeaient vers cette partie de la côte du Sussex qui s’étend entre Hastings
et Eastbourne. Leurs affaires les avaient poussés à quitter la grand-route pour emprunter une voie fort malaisée et leur voiture
versa alors qu’elle montait avec peine ce chemin mi-pierre, mi-sable.
L’accident se produisit à quelque distance de la seule maison de maître proche du chemin. Le cocher, lorsque les voyageurs
lui avaient demandé d’abord de se diriger vers cette maison, s’était imaginé que ce devait être leur destination et c’est
avec un air de regret qu’il avait reçu l’ordre de poursuivre sa route. Avec force grommellements et haussements d’épaules,
il avait plaint ses chevaux puis les avait fouettés si brutalement qu’on aurait pu le soupçonner d’avoir délibérément renversé
ses passagers — d’autant que la voiture n’était pas celle de son maître — si la route n’était pas devenue incontestablement
plus mauvaise aussitôt après ladite maison. D’un ton fort sinistre, le cocher avait affirmé que, passé la propriété, seules
des roues de charrette auraient pu avancer sans danger.
La gravité de la chute fut tempérée par la lenteur du véhicule et l’étroitesse du chemin. Monsieur s’était tiré d’affaire
et était venu en aide à madame ; l’un et l’autre n’avaient d’abord éprouvé que choc et contusions. Mais en s’extrayant de
la voiture, le voyageur s’était foulé le pied. La douleur se faisant bientôt sentir, il dut cesser de morigéner le cocher
et de se féliciter de l’heureuse issue de cet accident pour son épouse et lui-même ; il lui fallut s’asseoir sur le talus
car il était incapable de se tenir debout.
« Quelque chose me fait mal ici, dit-il en portant la main à sa cheville. Mais qu’importe, mon amie, ajouta-t-il en lui adressant
un sourire, cela n’aurait pu se produire, vous le savez, en meilleur endroit. À quelque chose malheur est bon. Peut-être même
fallait-il l’espérer. Nous obtiendrons bientôt des secours. C’est là, j’imagine, qu’est mon remède (il désignait la façade pimpante d’une chaumière, située dans un pittoresque bosquet, sur une
éminence voisine). Cette demeure ne promet-elle pas d’être le lieu même que nous cherchons ? »
Son épouse souhaitait vivement qu’il en fût ainsi. Pétrifiée d’anxiété, elle ne pouvait rien faire ni suggérer. Sa première
consolation réelle lui vint en voyant plusieurs personnes accourir à leur secours.
L’accident avait été aperçu d’un champ de foin attenant à la maison qu’ils avaient dépassée. Les personnes qui s’approchaient
étaient un homme robuste, d’âge moyen, de belle prestance, l’air noble : c’était le propriétaire des lieux, qui assistait
alors à la fenaison, accompagné de quelques-uns de ses meilleurs faneurs, appelés aux côtés de leur maître, sans parler de
tous les autres, hommes, femmes et enfants, qui faisaient les foins non loin de là.
Mr. Heywood, car tel était le nom du propriétaire, s’avança avec un salut fort civil, une grande sollicitude quant à l’accident,
une certaine surprise à l’idée que l’on se fût risqué en voiture sur ce chemin et une offre immédiate d’assistance.
Sa courtoisie fut reçue avec politesse et gratitude et, tandis que deux ou trois hommes prêtaient main-forte au cocher pour
redresser la voiture, le voyageur dit :
« Vous êtes fort obligeant, monsieur, et je vous prends au mot. Le mal fait à ma jambe est bénin, je le crois, mais il vaut
toujours mieux en pareil cas, vous le savez, obtenir sans attendre l’opinion d’un chirurgien. Comme la route ne semble guère
propice à ce que j’aille chez lui moi-même, je vous prierai donc d’envoyer l’un de ces braves gens chercher le chirurgien.
— Le chirurgien ! s’exclama Mr. Heywood. Je crains que vous ne puissiez trouver aucun chirurgien dans les parages, mais je
suis sûr que nous nous en passerons fort bien.
— Pour cela, monsieur, s’il n’est pas là, son associé fera aussi bien l’affaire, et même mieux. J’aimerais mieux voir son
associé. À la vérité, oui, je préférerais être examiné par son associé. L’un de ces braves gens peut être chez lui en trois
minutes, j’en suis sûr. Il n’est pas besoin de demander si c’est bien là qu’habite le médecin, dit-il en regardant la chaumière,
car excepté votre maison, nous n’en avons passé aucune qui puisse être la demeure d’un honnête homme. »
Mr. Heywood parut fort étonné.
« Quoi, monsieur ! Vous espérez trouver un chirurgien dans cette chaumière ? Nous n’avons ni chirurgien ni associé dans cette
paroisse, je vous l’assure.
— Pardonnez-moi, monsieur, reprit l’autre. Je regrette de paraître vous contredire mais, par l’étendue de cette paroisse ou
pour quelque autre raison, peut-être ne savez-vous pas… attendez… me serais-je trompé sur l’endroit ? Ne suis-je pas à Willingden ?
N’est-ce pas ici Willingden ?
— Si, monsieur, assurément.
— Alors, monsieur, je peux vous apporter la preuve qu’il existe un chirurgien dans cette paroisse, que vous le sachiez ou
non. Tenez, monsieur (il sortait un carnet de sa poche), si vous me faites la faveur de porter votre regard sur ces annonces
que j’ai découpées moi-même dans le Courrier du matin et la Gazette du Kent pas plus tard qu’hier matin, à Londres, vous serez convaincu, je pense, que je ne parle pas au hasard. Vous y verrez annoncée,
dans votre paroisse, la séparation des deux médecins associés qui souhaitent s’établir chacun de leur côté ; clientèle abondante,
réputation indéniable, références respectables. Vous y trouverez tous les détails, monsieur (il lui tendait les deux petits
articles oblongs).
— Monsieur, même si vous me montriez tous les journaux que l’on imprime en une semaine dans tout le royaume, vous ne sauriez
me persuader qu’il existe un chirurgien à Willingden, dit Mr. Heywood avec un sourire aimable. Je vis ici depuis ma naissance,
il y a cinquante-sept ans, et je pense que je devrais connaître un tel personnage. Du moins, j’ose dire qu’il ne doit pas
avoir une grande clientèle.
1 comment