Voyage à Lilliput
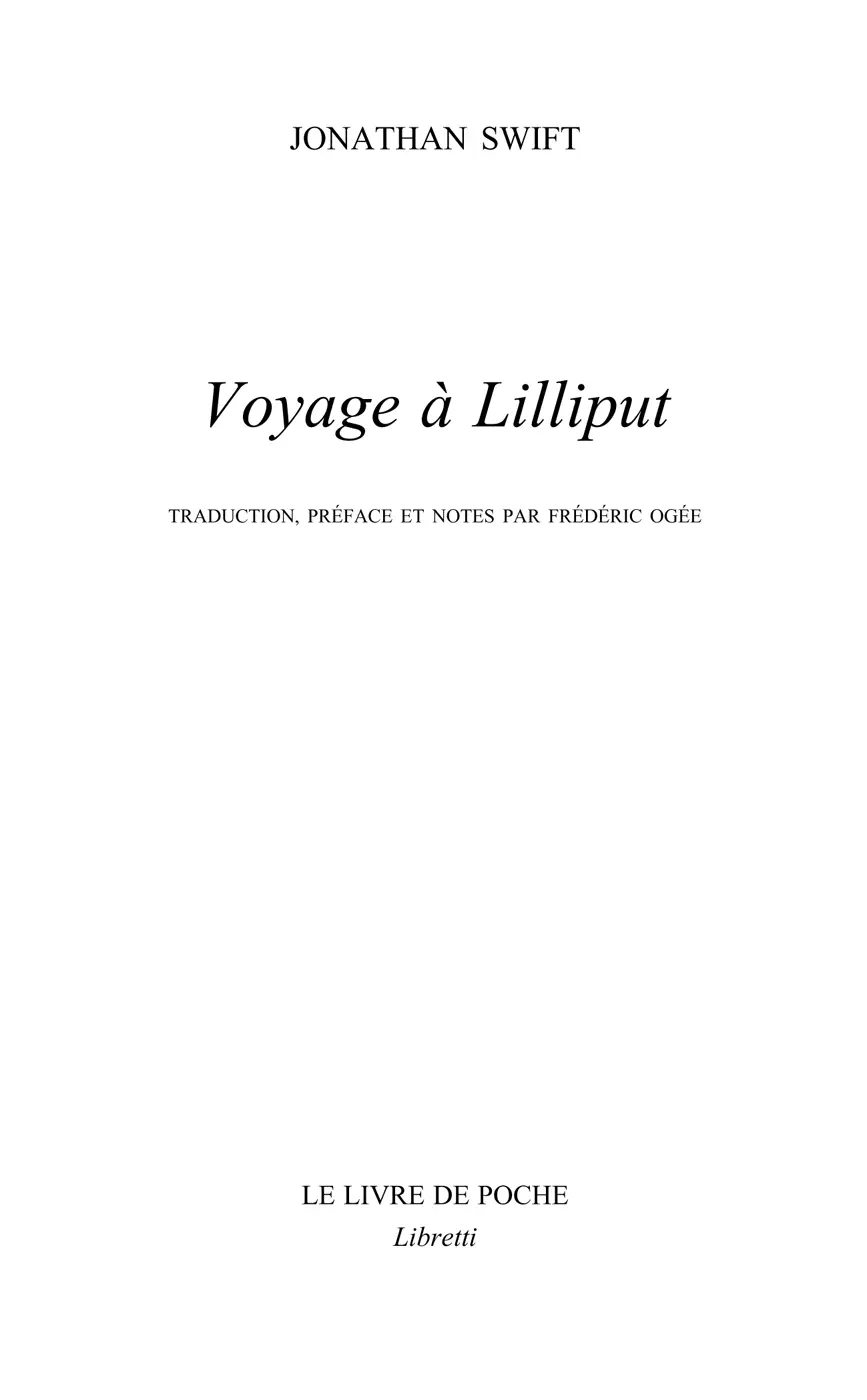
Avertissement de l’éditeur
Les numéros de pages et de notes de bas de pages apparaissant dans les renvois internes correspondent à ceux de l’édition papier. Dans cette édition numérique, des liens sont installés permettant d’accéder aux passages concernés, mais selon la taille de caractères sélectionnée, le numéro de page peut être différent de celui de l’édition papier.
PRÉFACE
It is a miserable thing to live in suspense ;
it is the life of a spider.
C’est une chose bien misérable que de vivre en suspens ;
c’est vivre comme une araignée.
Jonathan Swift, Thoughts on Various Subjects
(Pensées diverses), 1707.
Comme on ne le sait pas toujours de ce côté-ci de la Manche, c’est sans doute vers la fin du xviie siècle, dans les cercles scientifiques et philosophiques anglais, que s’est opérée l’une des plus fondamentales révolutions de la pensée occidentale grâce à la création, dans les années 1660, de la Société royale de Londres « pour le progrès de la connaissance naturelle », sorte d’Académie de toutes les sciences. Ses innombrables expériences pluridisciplinaires permirent l’avènement d’une approche radicalement nouvelle de l’homme et de la nature, portée à la connaissance de tous par la publication régulière de ses Philosophical Transactions. Cette approche ne se fondait plus, comme par le passé, sur la recherche dans la nature de confirmations a posteriori de théories ou de systèmes élaborés abstraitement, mais sur la volonté d’enregistrer, de relever, de noter le fonctionnement de la nature, y compris la nature humaine, dans tout ce qu’elle peut avoir de particulier et de divers, avant d’aboutir à la formulation de ses « lois ». Cette nouvelle démarche, souvent figurée de façon simpliste mais néanmoins juste par Newton et sa pomme, inaugura la science moderne telle que nous la pratiquons aujourd’hui.
À la même époque, on trouve une formulation philosophique de cette approche dans les écrits de John Locke, surtout son Essai sur l’entendement humain (première édition en 1690), dans lequel il expose et défend les mérites d’une démarche empirique, la connaissance dérivant de l’expérience sensorielle des choses. Il s’agit de devenir les « spectateurs » attentifs et curieux d’une nature que, entre autres, les nombreux et populaires récits de voyages publiés alors révélaient comme étant parfois bien différente des idées préconçues qui avaient cours à l’époque.
Significatif de cette nouvelle volonté de voir, le formidable développement de l’optique et de l’analyse de la lumière qui, avec des savants comme Huyghens, Newton, Gregory et Hadley, connaissent un essor sans précédent. De même, dans tous les écrits (scientifiques, philosophiques, esthétiques), c’est la vue qui devient le sens prépondérant. Pour Locke, pour Joseph Addison – le rédacteur principal du journal The Spectator (1711-1714), au titre révélateur – mais aussi pour l’ami de Swift, le philosophe George Berkeley, la vue est mise en avant comme le sens le plus « instructif », et Berkeley développe l’une des premières psychologies de la perception autour de cette faculté de vision.
Les Voyages de Gulliver, que Jonathan Swift publie en 1726, est à bien des égards l’enfant de cette nouvelle « façon de voir », de cette nouvelle épistémologie. Composé de quatre parties distinctes – quatre récits des voyages entrepris par un médecin de la marine (donc un scientifique de formation, comme il le précise au début de son récit) –, le livre propose successivement quatre regards sur le genre humain, ses pratiques et ses mœurs. D’abord vu par le petit bout de la lorgnette (Première partie : Voyage à Lilliput), celui-ci est ensuite observé au microscope (Deuxième partie : Voyage à Brobdingnag). Dans le premier cas, Gulliver est un géant qui domine son sujet : il peut donc embrasser du regard de grands panoramas des pratiques sociales et politiques des Lilliputiens, et rendre compte de tout ce qu’il y a de « petit » chez l’homme, particulièrement chez l’Homo politicus, que Swift connaissait bien. Dans le deuxième cas, Gulliver est à son tour infiniment petit et contraint de côtoyer, grossies plusieurs fois, toutes les difformités physiques des habitants de Brobdingnag. Mais la supériorité morale que Gulliver, désormais « insecte impuissant et servile », pense en retirer s’effondre dans les derniers chapitres, lorsqu’il a du mal à convaincre le roi de Brobdingnag que les mœurs politiques et guerrières des Européens ne sont pas, elles aussi, infiniment petites et méprisables.
Dans les deux cas, Gulliver note scrupuleusement tous les détails, et son observation est en premier lieu guidée par les réactions de son corps, qu’il décrit de façon plus précise que les voyageurs de l’époque, puisqu’il n’hésite pas, par exemple, à évoquer les divers problèmes posés par la production et l’élimination de ses propres excréments lorsqu’il est un géant. Mais la gravité mordante de la satire, à la fin du deuxième Voyage, inaugure une nouvelle approche de l’observation : Swift fixe ensuite son regard sur l’esprit et la morale des humains, en proposant deux visions obliques sur leurs pratiques. Sur l’île volante de Laputa (Troisième partie : Voyage à Laputa, Balnibarbi, Glubbdubrib, Luggnagg, et au Japon), savants et philosophes, enfermés dans des spéculations aussi futiles que grotesques, passent à côté de tout ce qui fait la nature et la vie. (Car Swift est conscient du fait que les nouvelles méthodes scientifiques, quand elles tournent à l’obsession ou au dogmatisme, peuvent fort bien nous fourvoyer autant que les vieilles fictions médiévales et le « merveilleux » populaire, et il fait ici preuve d’une grande méfiance.) Enfin, au pays des Houyhnhnms (Quatrième partie : Voyage au pays des Houyhnhnms), la sagesse et le bon sens de ces chevaux doués de raison s’opposent à la bestialité des Yahoos, les humains qu’ils côtoient. Gulliver revient de ce dernier voyage empli du plus profond dégoût pour cette race humaine qui se prétend supérieure aux autres. Loin d’être cet « animal doué de raison » que décrit la philosophie, l’homme que révèle cette quadruple observation semble au contraire avoir usurpé sa place au sommet de l’échelle des êtres.
On cherche souvent des allusions historiques précises dans toutes ces sociétés que Gulliver décrit. S’il ne fait aucun doute que le livre contient nombre de clins d’œil à des pratiques, des situations et des événements contemporains de son écriture, une telle lecture est réductrice. Le projet swiftien, comme en atteste son succès ininterrompu depuis sa publication, dépasse de beaucoup la simple satire des mœurs de son temps. Fort des possibilités illimitées que lui offre l’optique de l’imaginaire, utilisant avec une grande maîtrise tous les instruments d’observation que permet la fiction (Gulliver fait un peu fonction de prisme), Swift décompose les diverses facettes de l’homme et de ses « sociétés », comme l’avait fait Newton avec la lumière. Il propose une analyse plurielle et approfondie de l’homme, du fonctionnement de son corps, de ses émotions, de son esprit. Si une verrue observée au microscope ressemble étrangement à un paysage lunaire, elle n’en est pas moins verrue.
Publié pour la première fois en octobre 1726 à Londres, le livre de Swift connaît immédiatement un succès considérable. Le premier tirage est épuisé en une semaine et deux réimpressions ont lieu avant la fin de l’année. Le livre est adapté et traduit dès 1727 en hollandais et en français. Pourtant, cette première édition a été sérieusement « arrangée » par l’éditeur Motte, qui a expurgé le texte de tous les passages qu’il considérait comme « inconvenants ». Swift, alors exilé en Irlande, ne peut en contrôler la sortie et doit attendre 1735 pour publier, à Dublin, une édition revue et corrigée de sa main, qui constitue le texte définitif.
L’ingéniosité et la simplicité de l’histoire que Swift raconte, les multiples possibilités que lui offrent les situations dans lesquelles il place son héros ont fait de son livre l’un des ouvrages favoris des enfants et des philosophes. À l’image de Gulliver, le livre a connu une grande variété de formats, de l’anthologie illustrée pour enfants aux traductions dans des dizaines de langues, de la bande dessinée aux adaptations pour le cinéma (quatre à ce jour, dont, en 1939, le dessin animé de Max et David Fleischer, prouesse technique pour l’époque, mais aussi infidèle que sirupeux), sans oublier les innombrables ouvrages critiques qui tentent, depuis près de trois siècles, d’en cerner le sens, chacun dans une « optique » particulière – littéraire, historique, religieuse, psychanalytique, marxiste, etc.
Par la force de la satire et la précision du détail, mais aussi par le refus du recours à l’image ou à la métaphore éclairante et par l’absence apparente de raisonnement conceptuel, le livre s’est également attiré les reproches d’un Samuel Johnson ou d’un William Thackeray. Ce dernier va jusqu’à le qualifier d’ouvrage « horrible, honteux, lâche, blasphématoire », et d’ajouter : « [Swift] a beau être un géant et un génie, je pense que nous devrions le conspuer. » Mais l’histoire littéraire a montré qu’un blâme de Johnson ou de Thackeray pouvait parfois être un gage de qualité…
D’optique et de vision, il est beaucoup question dans le Voyage à Lilliput. Ce que Gulliver cache aux officiers du Roi chargés de le fouiller, ce sont ses lunettes et sa lorgnette de poche.
1 comment