La dame du manoir de Wildfell Hall
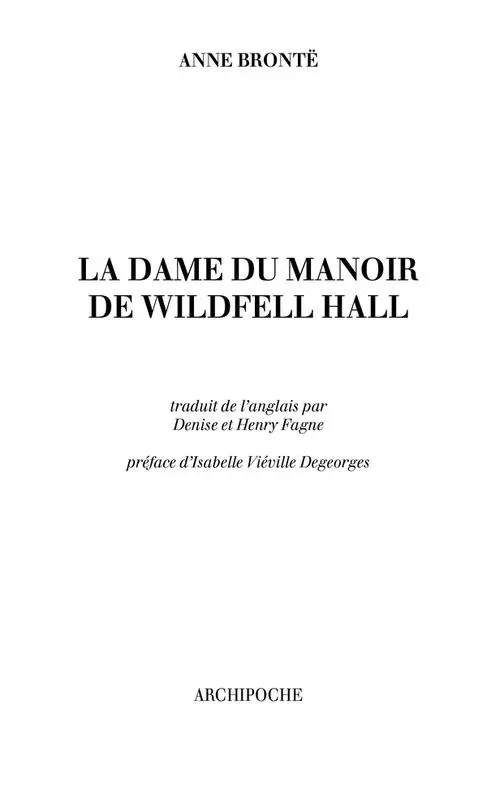
Collection dirigée par
Isabelle Viéville Degeorges
www.archipoche.com
Si vous souhaitez recevoir notre catalogue
et être tenu au courant de nos publications,
envoyez vos nom et adresse, en citant ce livre,
aux Éditions Archipoche,
34, rue des Bourdonnais 75001 Paris.
Et, pour le Canada, à Édipresse Inc.,
945, avenue Beaumont,
Montréal, Québec, H3N 1W3.
eISBN 978-2-3528-7361-7
Traduction, droits réservés.
Copyright © Archipoche, 2012, pour cette édition.
Sommaire
Page de titre
Page de Copyright
PRÉFACE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
PRÉFACE
Une vie entière semble séparer La Dame du manoir de Wildfell Hall du premier roman d’Anne Brontë, Agnès Grey. Pourtant, ces deux œuvres furent écrites à un an d’intervalle à peine. Un an pour passer du roman d’apprentissage d’une toute jeune fille de dix-neuf ans, confrontée pour la première fois au monde extérieur, à cette chronique intense et tourmentée de la déchéance d’un homme dans l’alcool et du naufrage de son couple. Comment expliquer la transformation de la jeune Anne, habituellement dépeinte comme la plus douce et la plus religieuse des sœurs Brontë, au point de la voir tracer un itinéraire si réaliste et soutenir, à travers son héroïne, des positions aussi scandaleuses? La réponse, comme toujours avec les sœurs Brontë, est à chercher au cœur de leur invraisemblable fratrie.
Fratrie bouillonnante, où le génie se décline à quatre et qui grandit, livrée à elle-même, dans l’austère presbytère de Haworth dont les fenêtres ouvrent sur le jardin cimetière et les tombes de leur mère et de leurs deux sœurs aînées. Entre les pierres grises de cette bâtisse, dans le creuset d’un Yorkshire en pleine mutation manufacturière, avec pour seules échappées les landes sauvages et désolées, la bibliothèque paternelle et les récits de drames populaires relayés par les deux
servantes, les enfants vivent dans une semi-autarcie, au cœur de leur imaginaire.
Charlotte, la plus ambitieuse socialement, est romanesque. Emily, sauvage, solitaire et indépendante, ne répond qu’à l’absolu. Anne, la cadette, est la plus sage. Au milieu d’elles, Branwell, le fils. De tous, le plus prometteur et le plus remarquable. En lui s’incarnent tous les talents, toutes les facilités, jusqu’à celle de pouvoir écrire simultanément deux textes différents de la main droite et de la main gauche. Une mémoire extraordinaire, la curiosité, la vivacité, la sensibilité, l’intelligence, la malice, l’humour – et, pour son malheur, le goût effréné des plaisirs. Porteur de tous les espoirs de son père, Branwell est destiné à la carrière militaire. Son hypersensibilité, ainsi que l’épilepsie et l’attachement viscéral du pasteur à son endroit, le confinent cependant au presbytère, où il est avant tout le principal compagnon de jeu et d’écriture de ses sœurs. Ce sont ses petits soldats, auxquels il offre un sujet à chacun, jetant les enfants à cœur perdu dans la genèse d’un monde à eux. Supports de leurs fantasmes, ces figurines engendrent les mondes d’Angria et Gondal. Devenus démiurges, les enfants consignent fiévreusement d’une écriture microscopique sur de minuscules livres les journaux, revues, cartes et aventures de leurs héros, leurs guerres, trahisons, amours incestueuses ou illicites. Charlotte et Branwell régissent Angria, Anne et Emily sont les génies de Gondal. Le jeu perdure jusqu’à l’âge adulte où ils auront encore des discussions passionnées concernant leurs héros.
Mais Branwell est un garçon. Fasciné par les enfants du voisinage, qu’il épie longuement, il finit par les rejoindre. Soudain, les guerres d’Angria se teintent d’une nouvelle violence physique. Devenu ami du fils du
fossoyeur, Branwell prend des chemins de traverse. Après son échec à l’Académie royale de peinture, quelque chose se brise en lui. Dissipé et noceur, il fréquente les cabarets, perd son emploi à la gare pour avoir détourné ou laissé détourner de l’argent et accepte de petits travaux mal rémunérés qu’il ne sait pas conserver. Pour finir, Anne, alors gouvernante depuis quatre ans chez les Robinson (expérience qu’elle relate dans Agnès Grey), le fait engager comme précepteur de leur fils Edmund. Mais quelques mois plus tard, elle donne mystérieusement sa démission. Branwell est renvoyé par le révérend avec une lettre cinglante faisant allusion à mots couverts à ses « agissements répréhensibles au-delà de toute expression ». La nature réelle de l’affaire n’est pas connue avec certitude. Fut-il amoureux de Mrs Lydia Robinson mère, comme il le prétendit après coup et comme tout le monde fut trop heureux de le faire savoir, ou plutôt d’Edmund, enfant de quatorze ans ayant encore l’avenir devant lui, en qui il se plaisait à se reconnaître?
Petit à petit, Branwell sombre dans une spirale autodestructrice, entrecoupée de terribles éclairs de lucidité. L’alcool, mais aussi l’opium, sont devenus ses meilleurs compagnons.
1 comment