Car vous
n'êtes pas seulement deux. Nous sommes déjà
trois !
– Alors, tu prends vraiment cela au
sérieux ?
– C'est la première idée sérieuse que je
rencontre dans ma vie !
Et la puissance de la loi caméléonne est si
grande que je me remis à considérer l'entreprise du Père Sogol comme, en effet, tout à
fait raisonnable.
CHAPITRE DEUXIÈME,
QUI EST CELUI
DES SUPPOSITIONS
Présentation des invités. – Un truc d'orateur. – Position du
problème. – Hypothèses insoutenables. – Jusqu'au bout de
l'absurdité. – Navigation non euclidienne dans une assiette. –
Astronomes de référence. – Comment le Mont Analogue existe
tout à fait comme s'il n'existait pas. – Une lueur sur la
véritable histoire de Merlin l'enchanteur. – De la méthode dans
l'invention. – La porte solaire. – Explication d'une anomalie
géographique. – Le milieu des terres. – Un calcul délicat. – Le
Rédempteur des milliardaires. – Un lâcheur poétique. – Un
lâcheur amical. – Une lâcheuse pathétique. – Un lâcheur
philosophique. – Précautions.
Le dimanche suivant, à deux heures de
l'après-midi, j'introduisais ma femme dans le
« laboratoire » du passage des Patriarches,
et, au bout d'une demi-heure, nous formions,
à trois, une association pour laquelle rien
d'impossible n'existait plus.
Le Père Sogol avait à peu près terminé ses
mystérieux calculs, mais il en réservait l'exposé pour un peu plus tard, quand tous les
invités seraient là. En attendant, nous
convînmes de nous décrire l'un à l'autre les
personnes que nous avions convoquées.
C'étaient, de mon côté :
IVAN LAPSE, 35 à 40 ans, russe, d'origine
finnoise, linguiste remarquable. Remarquable surtout entre tous les linguistes parce qu'il
était capable de s'exprimer, oralement ou par
écrit, avec simplicité, élégance et correction,
et cela, dans trois ou quatre langues différentes. Auteur de La langue des langues et d'une
Grammaire comparée des langages de gestes. Un
petit homme pâle, le crâne allongé et chauve
couronné de cheveux noirs, des yeux noirs,
obliques et longs, le nez fin, le visage rasé, la
bouche un peu triste. Excellent glaciairiste, il
avait un faible pour les bivouacs en haute
montagne.
ALPHONSE CAMARD, français, 50 ans, poète
fécond et estimé, barbu, gras de poitrine, avec
un air de veulerie un peu verlainienne, que
rachetait une belle voix chaude. Une maladie
de foie lui interdisant les longues courses, il
s'en consolait en écrivant de beaux poèmes
sur la montagne.
EMILE GORGE, français, 25 ans, journaliste, mondain, insinuant, passionné de musique et de chorégraphie, sur quoi il écrivait
brillamment. Virtuose du « rappel de
corde », préférant la descente à la montée.
Petit, bizarrement bâti, avec un corps maigre
et un visage grassouillet, une bouche épaisse,
et pour ainsi dire sans menton.
JUDITH PANCAKE, enfin, une amie de ma
femme, américaine, une trentaine d'années,
peintre de haute montagne. Elle est d'ailleurs
le seul véritable peintre de haute montagne
que je connaisse. Elle a très bien compris que
la vue que l'on a d'un haut sommet ne
s'inscrit pas dans les mêmes cadres perceptifs
qu'une nature morte ou un paysage ordinaire. Ses toiles expriment admirablement la
structure circulaire de l'espace, dans les hautes régions. Elle ne se prend pas pour une
« artiste ». Elle peint simplement pour « garder des souvenirs » de ses ascensions. Mais
elle le fait avec une telle conscience artisane,
que ses tableaux, avec leurs perspectives
courbes, rappellent d'une façon frappante ces
fresques où les anciens peintres religieux
essayaient de représenter les cercles concentriques des mondes célestes.
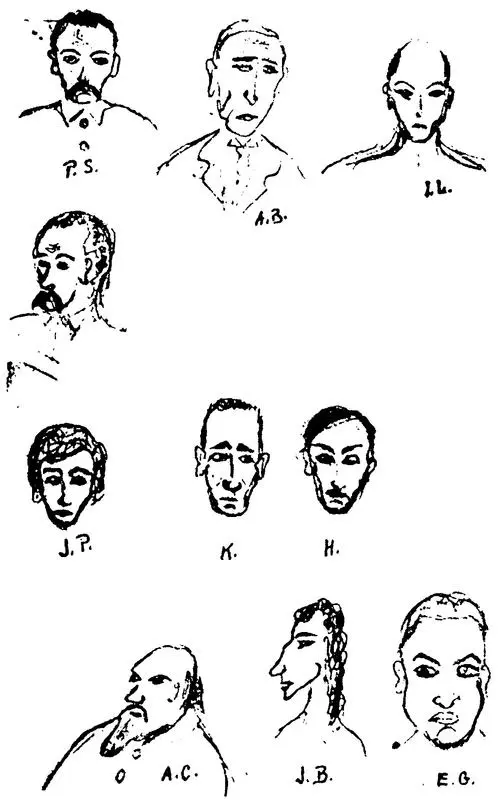
Du côté de Sogol, c'étaient, d'après sa
description :
ARTHUR BEAVER, de 45 à 50 ans, médecin ;
yachtman et alpiniste, donc anglais ; connaît
les noms latins, les mœurs et les propriétés de
tous les animaux et de toutes les plantes de
toutes les hautes montagnes du globe. N'est
vraiment heureux qu'au-dessus de 15000
pieds d'altitude. Il m'a interdit de publier
combien de temps et à l'aide de quoi il était
resté au sommet de quel pic de l'Himalaya
parce que, disait-il, « en tant que médecin,
que gentleman et que véritable alpiniste, il se
méfiait de la gloire comme d'une peste ». Il
avait un grand corps osseux, des cheveux or
et argent plus pâles que son visage tanné, des
sourcils haut perchés et des lèvres qui ondulaient finement entre la naïveté et l'ironie.
HANS et KARL, deux frères – on ne
prononçait jamais leur nom de famille –,
d'environ 25 et 28 ans respectivement, autrichiens, spécialistes des escalades acrobatiques. Blonds tous les deux, mais le premier
dans le genre ovoïde, le second dans le genre
rectangulaire. Des musculatures intelligentes,
avec des doigts d'acier et des yeux d'aigles.
Hans faisait des études de physique mathématique et d'astronomie. Karl s'intéressait
surtout aux métaphysiques orientales.
Arthur Beaver, Hans et Karl, étaient les
trois compagnons dont Sogol m'avait parlé et
qui formaient avec lui une insécable équipe.
JULIE BONASSE, 25 à 30 ans, belge, actrice.
Elle avait alors d'assez beaux succès sur les
scènes de Paris, de Bruxelles et de Genève.
Elle était la confidente d'une nuée de jeunes
gens falots, qu'elle guidait dans les voies de la
plus sublime spiritualité. Elle disait « j'adore
Ibsen » et « j'adore les éclairs au chocolat »
avec un ton d'égale conviction, qui vous
mettait l'eau à la bouche. Elle croyait à
l'existence de la « fée des glaciers » et, l'hiver,
skiait beaucoup dans les stations à téléphériques.
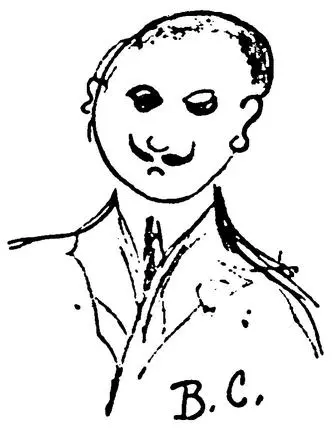
BENITO CICORIA, une trentaine d'années,
tailleur pour dames à Paris. Petit, coquet et
hégélien. Bien qu'italien d'origine, il appartenait à une école d'alpinisme que l'on pourrait
– grosso modo – appeler l'« école allemande ». On pourrait ainsi résumer la
méthode de cette école : on attaque la face la
plus abrupte de la montagne, par le couloir le
plus pourri et le plus mitraillé par les chutes
de pierre, et l'on monte vers le sommet tout
droit, sans se permettre de chercher des
détours plus commodes à gauche ou à droite ;
en général, on se fait tuer, mais, un jour ou
l'autre, une cordée nationale arrive vivante à
la cime.
Avec Sogol, ma femme et moi, cela faisait
douze personnes.
Les invités arrivèrent à peu près à l'heure.
Je veux dire par là que, le rendez-vous ayant
été fixé à quatre heures, Mr Beaver était là, le
premier, à trois heures cinquante-neuf, et que
Julie Bonasse, la dernière arrivée, bien
qu'ayant été retenue par une répétition, avait
fait son apparition à peine sonnée la demie de
cinq heures.
Après le brouhaha des présentations, on
s'installa autour d'une grande table à tréteaux et notre hôte prit la parole. Il rappela
les grands traits de la conversation qu'il avait
eue avec moi, affirma sa conviction de l'existence du Mont Analogue et déclara qu'il allait
organiser une expédition pour l'explorer.
– La plupart d'entre vous, poursuivit-il,
savent déjà la manière dont j'ai pu, en
première approximation, limiter le champ
des recherches. Mais deux ou trois personnes
ne sont pas encore au courant et, pour elles et
aussi pour rafraîchir la mémoire des autres, je
vais reprendre l'exposé de mes déductions.
Il me lança là-dessus un regard à la fois
malicieux et autoritaire, qui exigeait ma
complicité à cet adroit mensonge. Car personne n'était au courant de rien, bien
entendu. Mais, par cette simple ruse, chacun
avait l'impression de faire partie d'une minorité ignorante, d'être un des « deux ou trois
qui n'étaient pas au courant », croyait sentir
autour de lui la force d'une majorité convaincue, et avait hâte d'être convaincu à son tour.
Cette méthode de Sogol pour mettre, comme
il me le dit plus tard, « l'auditoire dans sa
poche » était une simple application –
disait-il – de la méthode mathématique qui
consiste à « considérer le problème comme
résolu » ; ou encore, sautant dans la chimie,
« un exemple d'une réaction de proche en
proche ». Mais si cette ruse était au service de
la vérité, pouvait-on encore l'appeler mensonge ? Toujours est-il que chacun tendit ses
plus intimes oreilles.
– Je résume, dit-il, les données du problème.
1 comment