Obéron
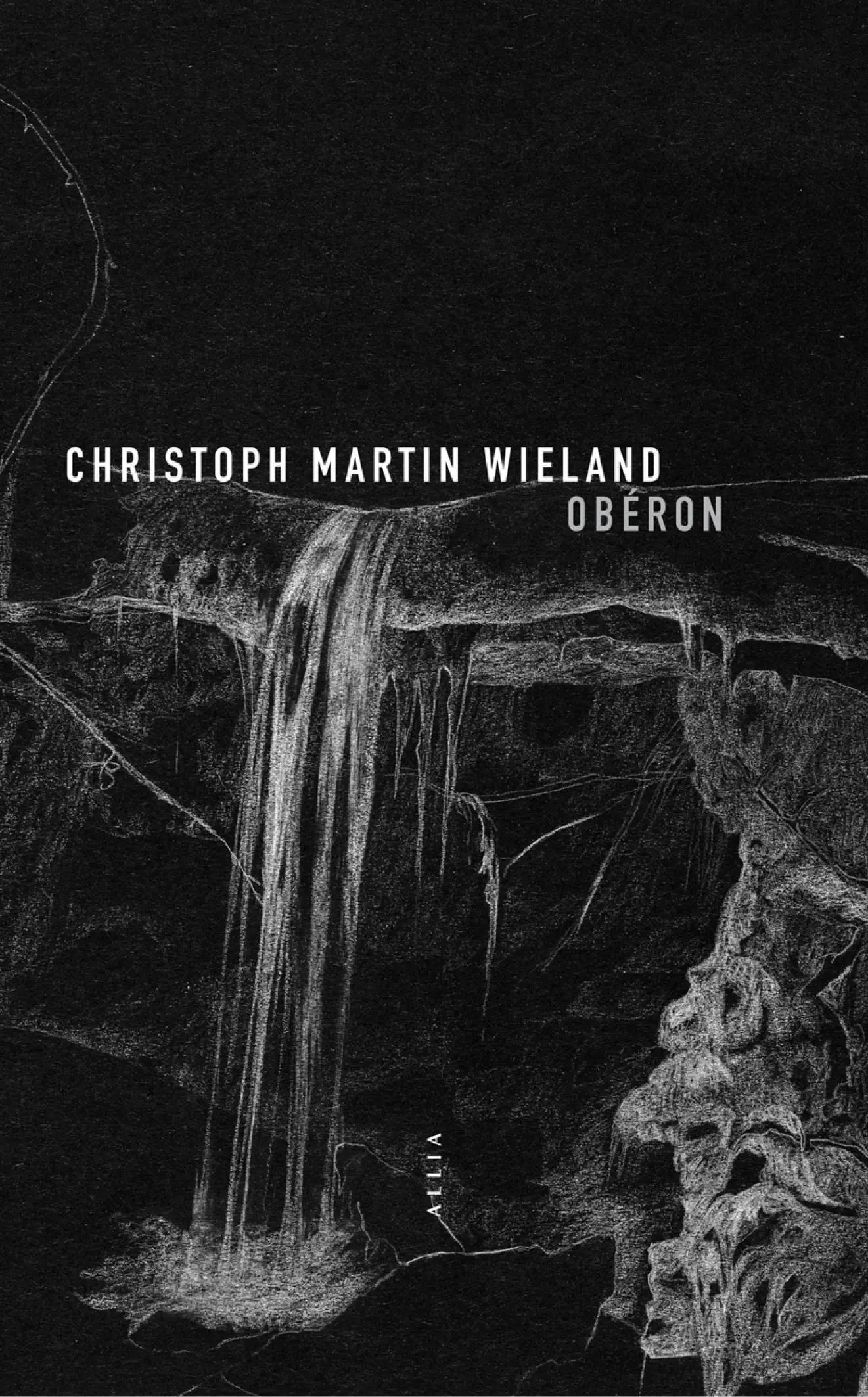
Titre
CHRISTOPH MARTIN WIELAND
Obéron
Traduit de l'allemand par
D'HOLBACH FILS
Chant premier
CHANT PREMIER
MUSES ! encore une fois sellez-moi l'Hippogriffe ; je veux voyager dans les régions romantiques. Quel délire s'empare de mon imagination ! qui a ceint mon front du bandeau magique ? quel être a dissipé le brouillard qui voilait à mes yeux les merveilles du temps passé ? Dans la mêlée, je vois briller le glaive du bon chevalier et le fer étincelant des païens : je vois la victoire passer alternativement d'un parti dans l'autre. En vain le vieux sultan rugit de colère, en vain des milliers de lances présentent leurs pointes menaçantes ; le cor d'ivoire a fait entendre ses sons chéris… et tout à coup la fureur de la danse s'empare d'eux tous ; ils tournent jusqu'à en perdre et l'haleine et les sens. Triomphe, chevalier, triomphe, la belle est à toi. Que tardez-vous ? partez ! les vents agitent les voiles : allez à Rome faire couronner vos nœuds par le saint pontife. Gardez-vous seulement de cueillir, avant le temps, un fruit bien doux, il est vrai, mais qui vous est encore interdit. Patience ! le vent le plus favorable seconde votre fuite : deux jours encore, et vous verrez paraître les côtes dorées de l'Hespérie. Oh ! fidèle Schérasmin, sauve, sauve-les, s'il est possible. – Mais, hélas ! il est trop tard ! ces âmes enivrées n'entendent pas même le tonnerre. Infortunés ! où vous entraîne un seul instant d'oubli ? Ah ! l'amour peut-il entraîner dans des égarements si funestes ? Dans quel abîme de douleurs les a-t-il précipités ! Qui apaisera la colère du jeune demi-dieu ? Voyez comme ils sont, ballottés par les flots ! Leurs bras sont entrelacés, heureux encore par l'espoir de périr unis l'un à l'autre. Ah ! ne vous en flattez pas ! Trop irrité contre vous, Obéron vous refuse la mort, dernière et misérable consolation de l'être souffrant. Destinés à des tourments plus terribles, je les vois nus, sans secours, errer sur un rivage désert : une caverne est leur demeure, leur lit une poignée de roseaux secs ou pourris ; leur nourriture, des mûres sauvages que la nature avare a parsemées çà et là sur des buissons arides. Dans leurs besoins pressants, ils n'aperçoivent, dans le lointain, la fumée d'aucune cabane, pas un être secourable, l'univers entier a conspiré leur perte.
Le courroux du génie n'est pas encore assouvi : leur misère n'est pas encore au comble ; elle entretient seulement leur flamme criminelle ; ils souffrent, mais ils souffrent ensemble. Qu'ils soient arrachés l'un à l'autre ! Ainsi tandis que le tonnerre gronde, que l'éclair brille, l'affreuse tempête sépare deux vaisseaux ; ils arrivent chacun dans un port différent, et là s'évanouit le faible espoir qu'ils avaient de se réunir. Cette infortune leur manquait encore. Ô toi qui fus naguère leur bon génie, leur ami ! dis-moi si les fautes que l'amour fait commettre méritent un tel excès de rigueur ! Malheur à vous ! je vois des larmes briller dans ses yeux : attendez-vous à tout ce qu'il y a de plus épouvantable quand Obéron pleure ! –
Muse, où t'entraîne ton imagination égarée ? Regarde, tes auditeurs sont troublés, interdits, et les prodiges que tu vois sont pour eux des mystères. Viens, prends place près de nous sur ce sofa, et, au lieu de crier : Je vois… je vois… ce que personne ne voit que toi, fais-nous tranquillement le récit de ces événements merveilleux. Nous sommes tous attentifs, les yeux ouverts, la bouche béante, et très disposés à nous laisser tromper, si ton imagination t'en fournit les moyens. – Hé bien soit : commençons.
Le paladin dont nous allons vous raconter les aventures pour vous divertir (s'il est possible), avait fait serment d'aller à Babylone. L'affaire qui l'appelait en cette ville était extrêmement périlleuse, même au temps de Charlemagne ; dans le nôtre, pas un seul chevalier ne s'exposerait à pareil danger pour la plus brillante renommée. Avant son départ, il se jette aux pieds de son oncle, le saint pontife de Rome, les arrose des larmes du repentir, après avoir, en bon chrétien, fait l'aveu de ses fautes.
“Mon fils, lui dit ce vénérable vieillard en lui donnant la bénédiction, l'aventure que tu vas entreprendre sera couronnée de succès ; mais avant tout, à ton arrivée à Joppé, crois-moi, va visiter le saint tombeau.”
Le chevalier se prosterne, baise humblement sa pantoufle sacrée, jure d'obéir à ses avis, et part plein de confiance.
L'entreprise à laquelle l'empereur l'avait condamné était difficile ; mais, avec l'aide de Dieu et de saint Christophe, il espère la mettre glorieusement à fin. Il débarque à Joppé, un bâton de pèlerin dans sa main, prend la route du saint tombeau, et sent redoubler son courage et sa foi. Il vole de là vers Bagdad, et se croit sans cesse au moment d'y arriver ; mais il lui faut franchir auparavant plus d'une montagne escarpée, plus d'un désert, plus d'une épaisse forêt ; et, malheureusement, la langue du pays lui était aussi inconnue que celle des bords de la Garonne l'était aux pauvres païens. “Est-ce là le chemin de Bagdad ?” demande-t-il à tous les passants ; et personne ne comprend la question. Conduit un jour au milieu d'une forêt, il y erre longtemps de droite et de gauche, poursuivi par l'orage et la pluie, obligé souvent de se frayer, avec son épée, un passage au travers d'épaisses broussailles. Il s'élance sur une colline pour observer les objets qui l'environnent. Malheur au pauvre chevalier ! il ne voit que des bois. Plus il regarde et plus leur étendue s'accroît à ses yeux. Cet effet naturel lui paraît un prodige. Que va-t-il devenir, lorsque la nuit le surprendra dans ces lieux sauvages, dont en plein jour il lui semble impossible de trouver l'issue ? Son inquiétude est au comble. Pas une étoile ne perce la voûte de la forêt.
1 comment